- Archives du BAC (43 531)
- Art (11 061)
- Biographies (6 177)
- Divers (47 453)
- Histoire et Géographie (17 971)
- Littérature (30 270)
- Loisirs et Sports (3 295)
- Monde du Travail (32 158)
- Philosophie (9 544)
- Politique et International (18 653)
- Psychologie (2 956)
- Rapports de Stage (6 975)
- Religion et Spiritualité (1 441)
- Sante et Culture (6 435)
- Sciences Economiques et Sociales (23 576)
- Sciences et Technologies (11 297)
- Société (10 929)
- Page d'accueil
- / Histoire et Géographie
- / Géographie

La coexistence pacifique
Par dissertation • 30 Avril 2013 • Fiche • 824 Mots (4 Pages) • 16 807 Vues
coexistence pacifique
Cet article fait partie du DOSSIER consacré à la guerre froide.
Principe selon lequel deux États ou groupes d'États, aux idéologies opposées, acceptent de ne pas entrer en conflit armé.
2. Les causes de la coexistence pacifique
2.1. L'impasse stratégique et militaire
Mais ce sont surtout les causes stratégiques et militaires qui sont à l'origine de ce revirement : après la Seconde Guerre mondiale, les Américains étaient les seuls à posséder l'arme atomique, ce qui leur conférait une supériorité militaire sans précédent. Les Soviétiques mirent fin à ce monopole en se dotant de la bombe A (1949), de la bombe H (1953), puis en lançant Spoutnik (1957), ce qui eut un retentissement considérable aux États-Unis.
Étant parvenus à un niveau technologique équivalent, les deux Grands se devaient, pour éviter un affrontement nucléaire général, de cohabiter et de reconnaître leurs sphères d'influence respectives.
2.2. De nouvelles conditions internationales
L'adoption par l'URSS de la doctrine de la coexistence pacifique s'explique par divers facteurs : changement du personnel politique en URSS (mort de Staline en 1953, remplacé par Khrouchtchev), émergence du tiers-monde et du mouvement des non-alignés (conférence de Bandung en 1955), fin des conflits armés en Corée (1953) et en Indochine (1954), départ des Soviétiques d'Autriche (1955).
Les manifestations
Après la crise de Cuba, les relations américano-soviétiques s'améliorèrent. Dès juin 1963, un « téléphone rouge » fut instauré entre la Maison Blanche et le Kremlin, permettant aux deux Grands de maintenir un lien permanent afin d'éviter le déclenchement d'une guerre nucléaire par « accident ». Les deux Grands signèrent par la suite toute une série d'accords stratégiques et militaires visant à limiter la course aux armements, ainsi que d'autres concernant les domaines politiques et économiques. Cette nouvelle phase des relations internationales qui succède à la guerre froide est appelée « la détente ».
3.1. Les accords de désarmement
Les accords de Moscou (1963)
Les accords de Moscou signés le 5 août 1963 par les ministres des Affaires étrangères de l'Union soviétique, du Royaume-Uni et des États-Unis furent les premiers à proscrire les essais nucléaires (à l'exception cependant des essais souterrains).
Le traité de non-prolifération nucléaire (1968)
Ils furent suivis par un traité de non-prolifération (TNP) des armes nucléaires (1968) qui interdisait aux détenteurs de l'arme nucléaire de fournir à quelqu'État que ce soit des armes de ce type, des composantes ou des matières premières permettant d'en construire, ou d'inciter les États qui n'en n'étaient pas dotés à en fabriquer. Ces derniers s'engageaient, de leur côté, à ne pas chercher à produire ou à acquérir ces armes. Le traité favorisait également le développement du nucléaire civil. Il ne fut signé
Site collaboratif, dédié à l'histoire. Les mythes, les personnages, les batailles, les équipements militaires. De l'antiquité à l'époque moderne, découvrez l'histoire, commentez et posez vos questions, participez à la vie du site !
- Guerre froide et decolonisation
- Guerre froide
- Coexistence pacifique et nouvelles crises (1953-1962)
mercredi 10 octobre 2007 , par HistoireDuMonde.net
La coexistence pacifique
Le 5 mars 1953, Staline meurt. Il est remplacé par Nikita Khrouchtchev, qui condamne les crimes de Staline et permet la coexistence pacifique (1956) : les deux blocs ne s’affrontent plus qu’idéologiquement.
Bien qu’officiellement les deux puissances ne se soient jamais affrontées directement, il semble que plus d’une centaine d’avions espions américains aient été abattus lors de survols de l’espace aérien soviétique. Dès 1950, un PB4Y Privateer est abattu par la chasse soviétique. À partir de 1956, les Américains utilisent des U2 volant à plus de 20 000 mètres d’altitude. Mais, en mai 1960, l’un d’eux est abattu et son pilote, Francis Gary Powers, est emprisonné à la suite d’un procès très médiatisé. Les Américains créeront alors des avions espions de plus en plus perfectionnés, avant de développer un programme de satellites de surveillance.
Durant cette période, il y a un dialogue plus ouvert entre les dirigeants des deux blocs. Khrouchtchev rencontre Eisenhower en 1956 au Royaume-Uni, en 1959 aux États-Unis, en 1960 en France et Kennedy en 1961 à Vienne[20]. En effet, le jeune démocrate John F. Kennedy a gagné les élections de 1960. Il préfère une coexistence pacifique avec l’URSS, mais veut en même temps empêcher le communisme de se répandre dans le tiers monde. Il créé donc « l’Alliance pour le Progrès » pour aider l’Amérique latine, il accroît l’aide américaine au Congo-Kinshasa, il envoie des « conseillers militaires » au Laos et au Viêt Nam.
L’insurrection de Budapest (1956)
Le bloc soviétique vit une importante crise cristallisée par la révolte hongroise à Budapest, laquelle mène à une répression soviétique au moment des Jeux Olympiques d’été de 1956.
La crise de Suez (1956)
Cette crise ne fait pas partie de la guerre froide au sens strict du terme, puisqu’elle n’est pas un conflit opposant de manière directe les États-Unis et l’URSS. Certains voient toutefois dans cette crise la fin des actions autonomes des deux blocs et l’intègrent donc à la guerre froide.
En 1956, le monde assiste à une guerre entre l’Égypte d’une part, la France, le Royaume-Uni et Israël d’autre part. La France et le Royaume-Uni subissent les pressions des deux superpuissances, lesquelles n’apprécient pas de ne pas avoir été mis au courant de l’opération autour du canal de Suez. L’URSS menace d’utiliser l’arme atomique, car elle y voit une guerre coloniale. Dans ce dossier, les deux grandes puissances adoptent la même position. Article détaillé : Crise de Suez.
La deuxième crise de Berlin (1961)
Entre 1949 et 1961, 3.6 millions d’Allemands de l’Est transitèrent par Berlin pour passer en RFA. Cette hémorragie démographique était un désastre économique pour la RDA, car c’étaient surtout des ingénieurs, des médecins et des ouvriers spécialisés qui commirent le « délit de fuite » (Republikflucht). En même temps, elle était une catastrophe politique en ce qu’elle portait atteinte à l’image de marque officielle de la RDA.
En novembre 1958, cette situation donna lieu à une crise diplomatique connue sous le nom d’« ultimatum de Khrouchtchev » et dans laquelle furent impliquées toutes les puissances occidentales.
En juin 1961, Kennedy et Khrouchtchev se rencontrent à Vienne. Khrouchtchev annonce qu’il va signer un traité de paix avec la RDA, ce qui priverait les États-Unis de leur accès à Berlin-Ouest. Kennedy juge la situation inacceptable et la conférence ne mène à rien. Khrouchtchev envoie son armée devant Berlin-Ouest. Kennedy riposte en étalant les chars américains devant les forces soviétiques et en augmentant le budget militaire américain. Khrouchtchev recule son armée sous la pression.
Le 13 août 1961, la construction du Mur de Berlin entre le secteur soviétique et les trois secteurs occidentaux met fin à ce « débauchage systématique de citoyens de la République démocratique allemande ». Mais, étant donné que les autorités est-allemandes et soviétiques ne firent aucune tentative pour bloquer les voies de communication entre la RFA et Berlin-Ouest et que, par ailleurs, Khrouchtchev ne mit pas en question le statut quadripartite de la ville, la réaction des Occidentaux se limita à des protestations verbales et à des gestes symboliques : la visite à Berlin-Ouest du général Lucius D. Clay, l’organisateur du pont aérien, et le renforcement de la garnison américaine par 1 500 hommes. En effet, aux yeux des Occidentaux, la construction du mur ne constituait qu’une agression à l’égard des Allemands de l’Est et ne menaçait pas les three essentials (c’est-à-dire les intérêts essentiels) du bloc de l’Ouest. Article détaillé : Mur de Berlin.
La crise des missiles cubains (1962)
La crise des missiles cubains[24] mit plus nettement en évidence la menace d’une guerre nucléaire. En janvier 1959, les guérilleros de Fidel Castro avaient renversé le dictateur Fulgencio Batista, soutenu par les États-Unis. Le nouveau régime prit une série de mesures qui lui valurent l’hostilité croissante de Washington : en 1959, démantèlement des latifundia ; signature d’un accord commercial avec l’Union soviétique en mai 1960, après la réduction des achats de sucre cubain par les États-Unis ; en juin et juillet, confiscation des entreprises nord-américaines, qui contrôlaient, outre la totalité des raffineries de pétrole, 40 % de l’industrie sucrière, 80 % du tabac et 90 % des mines.
À titre de représailles, le gouvernement américain, soumis à la pression des milieux d’affaires, mit en place un embargo économique de l’île en octobre 1960 et, le 2 janvier 1961, il rompit les relations diplomatiques avec La Havane. En même temps, la CIA recrutait des « forces anticastristes » parmi les réfugiés cubains. Au début du mois d’avril, Kennedy donna son accord à un projet d’invasion de l’île, tout en refusant d’engager des troupes américaines et en limitant les effectifs à 1 200 Cubains. Le débarquement, qui eut lieu le 17 avril 1961 dans la Baie des Cochons, fut un désastre. Kennedy se déclare seul responsable, mais, en privé, accuse la CIA de lui avoir menti et de l’avoir manipulé. Le président se brouille avec l’agence. Il déclare à ses conseillers : « Je vais tailler la CIA en pièces et en répandre les lambeaux à tous les vents. »La CIA œuvre désormais clandestinement contre Castro, en collaborant avec la Mafia, ce qui frustra Kennedy.
En juillet 1961, Cuba signifie son appartenance au « bloc socialiste ». Le 4 septembre 1962, le pays conclut un accord d’assistance militaire avec l’Union soviétique et, une semaine plus tard, Moscou déclare que toute attaque contre Cuba provoquerait une riposte nucléaire. Le Congrès américain pour sa part vote le 3 octobre une résolution qui met en demeure contre toute « action subversive dans l’hémisphère occidental ». Kennedy interdit cependant l’opération Northwoods mise au point et proposée par l’état-major, laquelle prévoyait d’orchestrer une série d’attentats contre les États-Unis, puis d’en accuser Cuba afin de mobiliser l’opinion publique contre Castro.
Le 14 octobre 1962, un avion américain U2 photographie sur l’île de Cuba des rampes de lancement pour missiles nucléaires à moyenne portée (IRBM et MRBM), capables d’atteindre le territoire américain. En même temps, la Maison Blanche apprend que 24 cargos soviétiques transportant des fusées et des bombardiers Iliouchine font route vers Cuba (opération Anadyr).
Dans la journée du 22, Kennedy, après avoir hésité entre l’inaction et le bombardement des rampes de lancement, se décide pour le blocus maritime de l’île. Cette « riposte graduée », proportionnée à la menace, laisse à Khrouchtchev le choix entre l’escalade ou la négociation. Mais Kennedy utilise la plus grande fermeté, afin de forcer Khrouchtchev à reculer. Le 24 octobre, les premiers cargos soviétiques font demi-tour. Moscou ne peut contacter immédiatement les sous-marins armés de torpilles à tête nucléaire (opération Kama) qui accompagnent le convoi avec mission de le protéger (fait qui ne sera révélé qu’en 2001). Entre-temps, un arrangement permettant à Khrouchtchev de sauver la face est négocié en coulisse entre émissaires officieux. Le 26 et le 27 octobre, dans deux messages, le Kremlin propose le retrait des armes offensives ; en contrepartie, les Américains devraient s’engager à ne pas renverser le régime cubain et à retirer les fusées Jupiter installées en Turquie, et pointées vers l’URSS. Le 28 octobre, Kennedy accepte ce compromis in extremis. Il demande toutefois de cacher le fait que les États-Unis retiraient leurs missiles de Turquie. Khrouchtchev accepta, et il crut avoir gagné la partie. Or, il avait été dupé. Kennedy avait décidé de retirer les missiles de Turquie bien avant la crise. De plus, la reculade de Khrouchtchev l’a humilié devant Castro, Mao Zedong et les autres chefs communistes. C’est décidement Kennedy qui a gagné la partie, en plus il voit sa popularité et son prestige mondial monter en flèche. Kennedy dira néanmoins après cette crise diplomatique qu’il a « négocié au bord du gouffre ».
Le dénouement de la crise fut un succès politique pour les États-Unis, quoiqu’ils doivent tolérer un pays communiste à l’intérieur de leur « périmètre de défense ». D’autre part, cette « diplomatie au bord du gouffre » avait effrayé « jusqu’aux plus hauts décideurs, au point de les rappeler à un comportement rationnel. »[26] L’installation d’un téléphone rouge, ligne directe entre Moscou et Washington, et l’ouverture de négociations sur la limitation des armements concrétisèrent ce retour à la rationalité. Kennedy, devenu encore plus populaire, change la politique de son pays vers un plan un peu plus pacifique. Mais il n’a pas le temps de mettre en place toutes ses idées : le 22 novembre 1963, en voyage à Dallas, Texas, Kennedy parade dans les rues de la ville en limousine décapotable. Lors du défilé, il est assassiné en pleine gloire par un tireur d’élite embusqué, et ce devant les yeux horrifiés de la foule. Khrouchtchev, quant à lui, sort très affaibli de la crise. En 1964, il fut remplacé par Brejnev.
sources wikipedia
Participez à la discussion, apportez des corrections ou compléments d'informations
Pour participer à ce forum, vous devez vous enregistrer au préalable. Merci d’indiquer ci-dessous l’identifiant personnel qui vous a été fourni. Si vous n’êtes pas enregistré, vous devez vous inscrire.
Dans la même rubrique
- Une reconstruction économique
- Une volonté de paix
- La mise en place des blocs et la question des armes nucléaires
- Les premières crises (1948-1953)
- « Guerre » idéologique : la chasse aux sorcières
- La « détente » (1963 - 1974)
- La guerre fraîche (1975 - 1985)
- L’œuvre de Gorbatchev : de la « nouvelle détente » à la fin du bloc soviétique
- L’implosion de l’Union soviétique et l’achèvement de la guerre froide (1989-1991)
- Chronologie de la Guerre Froide
- Conflit frontalier sino-soviétique de 1969
- Crise des missiles de Cuba
- Crise du canal de Suez
- La détente entre USA et URSS
- La dissidence soviétique
- La guerre froide sous Khrouchtchev
- La politique de soutien de l’URSS
- La politique Khrouchtchev
- Les crises de Berlin et de Cuba
- Les effets du printemps de Prague
- Les origines de la guerre froide
- Les prémices de la désintégration du bloc de l’Est
- L’Egypte de Nasser
- L’URSS de Brejnev
- MAD l’équilibre de la terreur
- Nikita Khrouchtchev
- USA contre URSS : ainsi commence la guerre froide...
Mots-clés associés
- guerre froide
Recherche dans le site
Réseaux sociaux.
Derniers commentaires
- 25 octobre 2023 Bonjour, Quelles sont les caractéristiques de cette arme, SVP ? : calibre, (…) par ZIELINSKI Richard
- 14 août 2023 Cet article sur la bataille de Tsushima et le contexte de la guerre (…) par Kiyo
- 27 avril 2023 Dans la mythologie grecque, Niké est la déesse de la victoire et de la (…) par Marc
- 27 avril 2023 Je crois pas que l’on puisse mettre une pièce jointe. par Marc
- 27 avril 2023 Les Vikings étaient un peuple scandinave qui a vécu pendant l’Âge Viking, (…) par Marc
- 27 avril 2023 Merlin est un personnage légendaire issu de la mythologie celte et (…) par Marc
- 9 mars 2023 Très intéressant comme article, merci pour le partage. je suis moi même un (…) par vikings76
- 12 janvier 2023 Une bouteille à la mer ! J’ai trouvé deux photos d’un jeune soldat dans les (…) par Marie
- 1er août 2022 Déess Niké, superbe article sur ma déesse ailée préférée dans la mythologie (…) par philou412
- 8 mars 2022 la nation des Sourikoes était composée d’une tribu d’origine les (…) par Gueherec
Vie pratique
mot de passe oublié ?
- IP : 185.80.151.41
Vous inscrire sur ce site
L’espace privé de ce site est ouvert aux visiteurs, après inscription. Une fois enregistré, vous pourrez consulter les articles en cours de rédaction, proposer des articles et participer à tous les forums.
Indiquez ici votre nom et votre adresse email. Votre identifiant personnel vous parviendra rapidement, par courrier électronique.
Veuillez laisser ce champ vide :

La coexistence pacifique et ses limites: Les limites de la coexistence pacifique

Début de la coexistence :
Entre les deux camps, Est-Ouest, la coexistence pacifique succède à la guerre froide. Dès la mort de Staline, s’était amorcé un dégel des relations, mais c’est surtout en 1955 que la signature du traité de paix concernant l’Autriche et la réconciliation des dirigeants soviétiques avec Tito illustrent le changement de la politique extérieure soviétique. Les facteurs sont essentiellement l’émergence du Tiers Monde et l’équilibre de la terreur. À la faveur de la décolonisation, sont nés en Asie et en Afrique des États qui refusent l’alignement sur l’Est ou sur l’Ouest et veulent vivre en paix : un nouvel acteur, le Tiers Monde, vient troubler le jeu bipolaire. D’autre part, la menace d’anéantissement que font peser les armes nucléaires n’est plus le monopole d’une seule puissance. Elle est bilatérale, équilibrée, bref : elle se neutralise. Sur le plan de l’équilibre mondial, la crise de Suez comme celle de Hongrie démontrent que les deux superpuissances ont préféré ne pas s’affronter. Les dirigeants soviétiques, et en particulier Nikita Khrouchtchev, sont plus rapides que les Américains à adapter leur politique à cette évolution. Dans son rapport au Soviet suprême, le 31 octobre 1959, Khrouchtchev abandonne l’idée d’une confrontation militaire inévitable entre les systèmes capitaliste et communiste. Même si la victoire du communisme reste l’objectif à long terme, la compétition doit se limiter aux terrains économique et idéologique.
Les limites de la coexistence pacifique :
De fait, entre 1955 et 1962 le style des relations diplomatiques change : les dirigeants soviétiques multiplient les voyages à l’étranger. Khrouchtchev rencontre Eisenhower aux États-Unis en septembre 1959, de Gaulle en France en mars 1960, Kennedy à Vienne en juin 1961. Et il privilégie désormais la compétition économique avec les Etats-Unis, en prédisant qu’en 1980 l’Union soviétique aura largement dépassé les États-Unis en matière de production. La victoire communiste doit se faire dans le domaine économique. Mais la guerre froide n’en continu pas moins. Elle affecte particulièrement son « épicentre », Berlin, à partir de 1958 et elle s’étend à l’Afrique à l’occasion des conflits de décolonisation, à l’Amérique latine avec la crise de Cuba, et à l’Asie dans le détroit de Formose où les communistes chinois bombardent les îles de la Chine nationaliste, Quemoy et Matsu (22-23 août 1958). Les Américains, par la voix de leur secrétaire d’État J.F. Dulles, prennent l’affaire très au sérieux et se déclarent prêts à aller jusqu’à la guerre. Cette crise dans le détroit de Formose intervient dans un contexte ambigu des relations entre l’Union soviétique, qui a promis à son allié une aide technique pour la fabrication d’un arsenal atomique, et la Chine qui se lance dans une profonde transformation interne connue sous le nom de « Grand Bond en avant », critiquée par Khrouchtchev lors de son voyage à Pékin en juillet 1958. Il faut donc voir dans cette crise un signe d’indépendance de la Chine à l’égard de l’Union soviétique, même si Khrouchtchev informe le président Eisenhower que toute attaque contre la Chine communiste serait considérée comme dirigée contre l’URSS. La crise s’apaise d’elle-même. La question de Taiwan est gelée.
L’équilibre de la terreur :
La diplomatie soviétique sait tirer parti du jeu de la dissuasion nucléaire en brandissant contre la France et l’Angleterre au moment de la crise de Suez la menace du feu nucléaire et en intimidant l’Amérique par l’utilisation de ses succès dans l’espace. Le succès soviétique dans l’espace. Le lancement du premier satellite artificiel de la Terre – le Spoutnik – par les Soviétiques, le 4 octobre 1957, et le premier vol d’un homme dans l’espace, le Soviétique Gagarine (12 avril 1961) représentent des exploits scientifiques et semblent prouver que l’URSS dispose de fusées à longue portée qui, lancées de son territoire, peuvent atteindre les États-Unis. Ceux-ci prennent conscience de ce qu’ils croient être leur retard, le missile gap. Ils décident d’entreprendre un effort gigantesque pour le rattraper. Le 25 mai 1961, le président Kennedy relève le défi et demande au Congrès un effort accru pour la conquête spatiale. C’est aussi le début d’une nouvelle course aux armements destinée non à anéantir l’adversaire, mais à l’essouffler et à garder la supériorité.
La nouvelle stratégie américaine :
En même temps, les États-Unis infléchis sent leur stratégie. Le nouveau président, le démocrate J.F. Kennedy, affirme la volonté des Etats-Unis de protéger le monde libre, mais, sous l’impulsion du secrétaire à la Défense, R. MacNamara, les démocrates remplacent la doctrine des représailles massives par celle de la riposte graduée. Celle-ci vise à proportionner la riposte à la menace et à l’enjeu, suivant une escalade savante allant du conflit conventionnel à la guerre nucléaire. Cette stratégie implique par conséquent la possession d’une panoplie complète d’armes et, en particulier, le renforcement des forces conventionnelles américaines, rendues plus mobiles, ainsi que dans l’ordre nucléaire, le développement de nouveaux moyens de riposte – telles les fusées Polaris. Elle s’accompagne d’une profonde réforme de l’administration de la Défense américaine, le Pentagone, dans le sens d’une centralisation du commandement suprême. Malgré les inquiétudes américaines sur le missile gap, l’URSS est en fait très en retard sur les États-Unis dans la course aux armements stratégiques. En 1962, Moscou dispose de 75 missiles intercontinentaux basés à terre et n’en fabrique que 25 par an. Les États-Unis possèdent déjà 294 missiles intercontinentaux et en fabriquent 100 par an. La supériorité américaine est encore plus écrasante dans le domaine des missiles sous-marins et des bombardiers intercontinentaux. Les premières négociations pour le désarmement. L’autre conséquence de l’équilibre de la terreur est la relance du désarmement. L’Union soviétique s’en fait le champion, appuie le projet Rapacki de dénucléarisation de l’Europe centrale (1957-1958) et décrète un moratoire sur les essais nucléaires. En 1958 s’ouvrent des négociations entre les trois puissances alors dotées de l’arme atomique afin d’aboutir à un arrêt des expériences nucléaires dans l’atmosphère. Parallèlement à ces pourparlers qui traînent en longueur, en avril 1961 les gouvernements américain et soviétique décident de reprendre les négociations dans un nouvel organisme, « le Comité des 18 », formé des représentants des puissances occidentales, orientales et non-alignées. Lors de la rencontre au sommet de Vienne (3-4 juin 1961), Khrouchtchev demande à Kennedy que les négociations sur les essais nucléaires soient replacées dans le cadre plus général du désarmement. En septembre 1961, les négociateurs américain et soviétique, MacCloy et Zorine, s’assignent un objectif ambitieux, le désarmement général et complet. Mais sa réalisation sera progressive, par étapes, de durée déterminée, équilibrée. En fait, la convergence américano-soviétique va entraîner l’abandon de la perspective d’une réduction générale des armements. Les deux super-Grands préfèrent désormais la négociation d’accords partiels et sélectifs.
Les crises de Berlin et de Cuba :

Le mur de Berlin
La crise connaît son apogée lors de la construction, dans la nuit du 12 au 13 août 1961, du «mur de Berlin» par les autorités allemandes, la limite entre les secteurs Est et Ouest de Berlin est hermétiquement barrée. L’hémorragie de la population est stoppée, mais le prix politique du « mur de la honte » est considérable. Au lendemain de la crise, le rôle de Berlin comme enjeu politique dans les rapports Est-Ouest semble perdre de son acuité. Cuba : le bras de fer des deux superpuissances. L’île de Cuba, ancienne possession espagnole, est, depuis la guerre hispano-américaine de 1898, indépendante sur le plan politique. Mais située à 150 kilomètres de la côte de Floride, elle vit sous la tutelle économique des États-Unis, qui y possèdent aussi la base militaire de Guantanamo. La prépondérance du sucre dans les exportations cubaines (80 % du total des exportations) renforce cette dépendance : si les États-Unis arrêtent leurs importations de sucre cubain, c’est la ruine. Une révolte larvée règne dans l’île, dirigée par le dictateur Batista, contre lequel un jeune avocat, Fidel Castro, anime depuis 1952 une lutte armée qui se transforme en guérilla de partisans. Le 26 juillet 1953, il lance une attaque qui échoue contre la caserne de Moncada et doit quitter le pays. De retour en 1956, réfugié dans ses bases de la Sierra Maestra, Fidel Castro entreprend, fin 1958, une offensive victorieuse. Le 31 décembre 1958, Batista, abandonné par les Américains, s’enfuit, laissant le pouvoir à Fidel Castro et à ses « Barbudos ». Les relations entre le nouveau régime cubain et les États-Unis ne se détériorent pas immédiatement. Mais au fur et à mesure que Castro veut dégager Cuba de l’emprise des États-Unis, il noue des liens de plus en plus étroits avec l’Union soviétique sur le plan diplomatique et sur le plan économique. En juillet 1960, l’annonce par un proche de Castro, Che Guevara, que Cuba fait partie du camp socialiste, est ressentie comme une atteinte inadmissible à la doctrine de Monroe, qui récuse toute intervention de pays non américains dans les affaires américaines. En octobre 1960, les États-Unis suspendent toute aide financière, arrêtent toute importation de sucre dans l’espoir d’asphyxier Cuba et rompent enfin les relations diplomatiques. La tension s’accroît aussi du fait des activités des réfugiés cubains et des effets de la réforme agraire sur les grandes compagnies américaines propriétaires de terres. Des exilés cubains, hostiles au régime de Fidel Castro, préparent une intervention militaire, avec le soutien américain. Mais leur débarquement dans la baie des Cochons échoue (15 avril 1961), ce qui porte un coup très dur au prestige du nouveau Président et accroît le raidissement du castrisme. Dans le but de renforcer les régimes anticommunistes en Amérique latine et d’enrayer ainsi la contagion anti-castriste, Kennedy propose en août 1961 à l’Organisation des États américains (OEA) un vaste programme d’aide, l’« Alliance pour le progrès» et, en janvier 1962, l’exclusion de Cuba de I’OEA. De leur côté les Cubains demandent et obtiennent des armes de l’URSS. En octobre 1962, les services américains ont la certitude qu’en fait les Soviétiques installent à Cuba des rampes de lancement de fusées de portée intermédiaire, susceptibles d’atteindre le territoire américain. Apprenant en ou Ire l’arrivée imminente de cargos soviétiques transportant fusées et bombes, le président Kennedy est confronté à un défi d’autant plus grave qu’il dépasse l’enjeu cubain. Les Soviétiques cherchent-ils à mesurer la volonté des Américains ? Ou veulent-ils contraindre les Américains à des concessions sur Berlin ? Résolu à une politique de fermeté, Kennedy va négocier « au bord du gouffre ». Il annonce, le 22 octobre, que la marine américaine établit un blocus autour de l’île pour intercepter les navires soviétiques et il demande à l’Union soviétique de démonter les installations existantes et de cesser d’armer Cuba. On paraît être au bord d’une troisième guerre mondiale. Le 26 octobre, à la faveur de discrètes tractations, Khrouchtchev cède : il donne l’ordre à ses navires de faire demi-tour et il propose de monnayer son acceptation des conditions américaines contre la promesse que les États-Unis renonceront à envahir Cuba et qu’eux-mêmes retireront leurs fusées installées en Turquie. Le 28 octobre, les Soviétiques acceptent de démonter et de ramener en URSS l’armement offensif installé à Cuba. Mais le règlement définitif du conflit tarde en raison de la mauvaise volonté et de la méfiance de Fidel Castro. La crise de Cuba est une date importante dans l’histoire des relations internationales. Elle constitue d’abord une vérification de la théorie de la dissuasion
Continuer à lire sur le même thème :
Tout savoir sur l’Impérialisme L’ordre impérial (depuis 2001) L’impérialisme japonais
Laisser une réponse Annuler la réponse
Votre mail ne sera pas publié
Votre Commentaire Merci:
Enregistrer mon nom, mon e-mail et mon site dans le navigateur pour mon prochain commentaire.
{{#message}}{{{message}}}{{/message}}{{^message}}Échec de l'envoi. Réponse du serveur : {{status_text}} (code {{status_code}}). Pour améliorer ce message, veuillez contacter le développeur de cet outil de traitement de formulaires. En savoir plus {{/message}}
{{#message}}{{{message}}}{{/message}}{{^message}}Votre envoi semble avoir été traité. Même si la réponse du serveur est positive, il est possible que votre envoi n'ait pas été traité. Pour améliorer ce message, veuillez contacter le développeur de cet outil de traitement de formulaires. En savoir plus {{/message}}
Top articles
PROMOTION ! -20% sur votre abonnement 1 mois avec le code JOURJ24 *Voir conditions

Lycée > Terminale STMG > Histoire > La coexistence pacifique : entre chaud et froid
La coexistence pacifique : entre chaud et froid
- Fiche de cours
Profs en ligne
- Application mobile
Ainsi, la situation allemande reste régie par les dispositions prises lors des conférences interalliées de 1945. La signature séparée d’un traité de paix par l’Union soviétique rendrait caduque ces dispositions de 1945 et risquerait d’entraver les accès occidentaux à Berlin-Ouest, enclave dans le territoire de la RDA. Mais les Occidentaux ne cèdent pas et une conférence réunie à Genève durant l’été 1959 n’apporte aucune solution à la question allemande. Bien que cette conférence soit un échec, elle marque une certaine avancée car c’est la première fois que les quatre grands Alliés de 1945 se retrouvent ensemble depuis la fin du procès de Nuremberg, en 1946.
Malgré la coexistence pacifique entre les deux superpuissances, les tensions restent très vives entre les deux blocs et entre les deux superpuissances. En particulier, l’Allemagne demeure une source de contentieux importants.
Vote en cours...
Vous avez déjà mis une note à ce cours.
Découvrez les autres cours offerts par Maxicours !
Comment as-tu trouvé ce cours ?
Évalue ce cours !
Nous sommes désolés que ce cours ne te soit pas utile
N'hésite pas à nous écrire pour nous faire part de tes suggestions d'amélioration
Puisque tu as trouvé ce cours utile
Je partage à mes amis
La médiane de 6 notes est 13. Cela signifie que :
la majorité des notes est 13.
la somme des 6 notes est égale au produit de 13 par 6.
il y a 3 notes inférieures ou égales à 13 et 3 notes supérieures ou égales à 13.
On a obtenu la série statistique suivante :
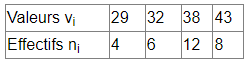
Combien vaut la médiane ?
environ 36,9
On a obtenu la série ci-dessous :
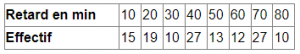
Quelle est la médiane de cette série ?
On a relevé les tailles en cm des élèves d’une classe :
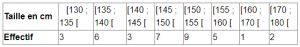
Parmi les propositions suivantes, laquelle est vraie ?
La classe modale de cette série est [150 ; 155[.
Le mode de cette série est 150.
Le mode de cette série est 9.
Les notes en français de deux classes littéraires sont données dans le tableau suivant :

Quelle est la note médiane ?
Vous avez obtenu 75% de bonnes réponses !
Reçois l’intégralité des bonnes réponses ainsi que les rappels de cours associés
Une erreur s'est produite, veuillez ré-essayer
Consultez votre boite email, vous y trouverez vos résultats de quiz!

Découvrez le soutien scolaire en ligne avec myMaxicours
Le service propose une plateforme de contenus interactifs, ludiques et variés pour les élèves du CP à la Terminale. Nous proposons des univers adaptés aux tranches d'âge afin de favoriser la concentration, encourager et motiver quel que soit le niveau. Nous souhaitons que chacun se sente bien pour apprendre et progresser en toute sérénité !
Fiches de cours les plus recherchées

La crise de Berlin
1947 : une année charnière
Vichy : un régime anti-républicain
Collaboration et Résistance
Les Trente Glorieuses
Entre malentendu et méfiance
L'ordre nazi en Europe
La sujétion de l'Europe
Bilan de la Seconde Guerre mondiale
Une hécatombe sans précédent
Accédez gratuitement à
Tout le contenu gratuit pendant 24h !
Exercices corrigés
Espace parents
Quiz interactifs
Podcasts de révisions
Cours en vidéo
Fiches de cours
Merci pour votre inscription
* Votre code d'accès sera envoyé à cette adresse e-mail. En renseignant votre e-mail, vous consentez à ce que vos données à caractère personnel soient traitées par SEJER, sous la marque myMaxicours, afin que SEJER puisse vous donner accès au service de soutien scolaire pendant 24h. Pour en savoir plus sur la gestion de vos données personnelles et pour exercer vos droits, vous pouvez consulter notre charte .
Votre adresse e-mail sera exclusivement utilisée pour vous envoyer notre newsletter. Vous pourrez vous désinscrire à tout moment, à travers le lien de désinscription présent dans chaque newsletter. Pour en savoir plus sur la gestion de vos données personnelles et pour exercer vos droits, vous pouvez consulter notre charte .

- Numéro du mois
- Manière de voir
- Hors-séries
Une étude de François Perroux
La coexistence pacifique : doctrine, illusion ou slogan ?
Jamais autant qu’aujourd’hui on n’a parlé de coexistence pacifique. L’expression, inventée par Staline bien avant la guerre, a gagné du terrain au point de figurer en bonne et due place dans la déclaration d’investiture de M. Michel Debré. Elle fournit aux harangues de M. Khrouchtchev, notamment lors de la visite de celui-ci aux Etats-Unis, leur leitmotiv.
De quoi s’agit-il au juste ? D’une doctrine raisonnable et riche de promesses ? D’une illusion ? D’un pur slogan de propagande ? C’est à ces questions que M. François Perroux a résolu de donner une réponse dans la copieuse étude qu’il vient de consacrer à la coexistence pacifique. L’ouvrage vient à son heure. Non seulement parce que le sujet est d’une extrême actualité, mais encore et surtout parce que personne, jusqu’à présent, n’a apporté à le traiter la rigueur intellectuelle, l’ampleur des connaissances et l’originalité des vues qui ont fait la réputation du professeur de la faculté de droit de Paris et du directeur de l’Institut d’économie appliquée, et lui ont valu sa chaire du Collège de France.
A u siècle du bâclage et de l’à-peu-près M. Perroux a le mérite insigne d’avoir déclaré la guerre à la facilité. Il n’avance rien qu’il n’ait vérifié par lui-même. Il sait que la valeur des chiffres est à la fois essentielle et limitée, que par trois points on ne peut faire passer qu’une circonférence, mais que par deux on peut en faire passer une infinité. Il excelle à saisir les multiples aspects d’un phénomène ; et son don de synthèse n’est pas moins grand que son esprit d’analyse. Enfin il ne confond pas l’objectivité avec l’indifférence. Les conclusions qu’il tire d’une recherche approfondie et impartiale, il les livre avec une magnifique vigueur. Toute son œuvre est celle d’un chercheur passionné, et dans tous les sens du terme d’un honnête homme.
C’est donc une attention extrême que mérite le nouveau livre de l’auteur de l’Europe sans rivages. Cette attention, il la leur demande d’ailleurs, car la clarté du style et de la pensée n’empêche pas la lecture de la Coexistence pacifique d’être plutôt austère. D’une part parce que M. Perroux juge nécessaire d’étudier avant de conclure jusque dans leurs fondements économiques, sociaux, structurels les plus subtils les deux systèmes qui se font face. De l’autre parce qu’il il se refuse à jouer, si peu que ce soit, les autruches, à se laisser prendre au piège des mots et des sourires. « La lutte entre l’Est et l’Ouest, écrit-il, exclut la réalité du compromis et l’esprit de compromis. L’interprète qui, dès le début, ne comprend pas cette exclusion ne comprend rien à l’essentiel de la lutte et à ses péripéties. » Quelle perspective ouvrir alors à la coexistence, sinon la découverte « d’un domaine d’activité où ait chance de s’établir le dialogue » ? C’est tout le problème « du développement de deux ensembles structurés et de l’universalisation, de la mondialisation, du développement économique » . Car le grand conflit de l’Est et de l’Ouest se déroule dans un monde qui « jouit des conditions techniques de son unification » .
Ayant ainsi posé le problème François Perroux procède à une analyse extrêmement poussée des deux types économiques qui s’affrontent, et dont les propagandes adverses présentent nécessairement des images ou bien idéalisées ou bien caricaturées. Au delà de ces simplifications abusives qui ne tiennent pas compte de la nécessité où se trouve chaque camp, précisément pour coexister, de s’altérer, de se gauchir, l’auteur n’a rien trouvé qui étaye les aspirations vagues de l’humanité à une synthèse des deux systèmes. Il a en revanche poussé fort loin une analyse des conditions réelles du développement économique dans les divers secteurs du monde qui s’écarte fort des notions toutes faites, faussées par le préjugé idéologique, auxquelles on nous a habitués de part et d’autre. Après avoir, au terme de cette analyse, constaté l’existence, quel que soit le système, d’un petit nombre de pôles de développement économique, il écrit que « si l’opposition se détend entre les deux coalitions la forme la plus efficace de collaboration serait encore la création en commun de tels pôles, à condition que soient abolies les vieilles règles des zones d’influence et du partage des butins » .
Mais ces pôles de développement à l’échelle du monde et leurs liaisons « dessinent une structure qui ne sera jamais mise au jour par l’examen des rapports entre les territoires nationaux et leurs échanges » . C’est pourquoi le savoir économique, « universaliste par la nature même de son objet », est bien obligé de constater la situation absurde qui résulte de la concordance de trois caractéristiques essentielles du monde moderne : 1) la nécessité et la possibilité de répondre à l’échelle planétaire à des besoins qui sont planétaires ; 2) ce que l’auteur appelle la prise de conscience de l’originalité de l’espèce ; 3) enfin la coexistence dite « pacifique », mais en réalité « hostile ».
François Perroux se situe donc avec résolution dans le camp des « mondialistes », de ceux qui ne se satisfont pas de l’impasse actuelle, qui n’attendent rien de bon de sa prolongation, qui savent qu’il est impossible qu’un camp l’emporte définitivement sur l’autre sans une masse énorme de misère et de gaspillage, sinon sans guerre. Beaucoup de voix se sont fait récemment entendre dans le même sens, et notamment celle de M. Richard Nixon, qui a repris avec beaucoup de bonheur devant la télévision soviétique, face aux slogans de coexistence de M. Khrouchtchev, la notion d’un monde uni (One World) développée jadis par Wendell Wilkie.
Déjà d’ailleurs les Nations unies, en dépit de divers reculs de fait, enregistrent la prise de conscience progressive par la collectivité humaine dans son ensemble de ces tâches élémentaires qui ont nom : « Nourrir les hommes, soigner les hommes, libérer les esclaves. » Mais là encore il ne s’agit que de formules vagues aussi longtemps qu’on n’a pas clairement explicité leur contenu. C’est ce à quoi M. Perroux s’emploie avec bonheur dans le dernier tome de son nouveau livre. Rarement sans doute on avait montré avec autant de pénétration comment les grands de ce monde dépensent leur argent et comment ils devraient le faire s’ils avaient un grain de sagesse en tête. Rarement on avait si bien mis le doigt sur les dangers mortels qui menacent à court terme l’espèce si elle ne se ressaisit pas. Mais si la solution est décrite, elle n’est pas à portée de la main, puisqu’il s’agit de rien de moins que de « mutations profondes » dans les institutions et les structures mentales pour aboutir à une « autorité mondiale ». Vues de prophète et d’utopiste, diront, condescendants, les gardiens des traditions. Ceux-là mêmes qui découvrent aujourd’hui l’Europe dont ils se gaussaient hier au nom des mêmes traditions et en vertu des mêmes réflexes, et qui ne voient pas que l’Europe, échelon nécessaire, n’est elle-même désormais qu’une réalité anachronique si elle ne s’élargit pas à l’échelle du monde.
A la vérité, le livre de François Perroux ne peut laisser personne indifférent. A ceux qui depuis longtemps savent que le seul chemin d’un espoir pour les hommes se situe dans les perspectives qu’il trace il apportera mille arguments pour nourrir leur conviction. A tout esprit honnête il révélera bien des aspects inédits de la situation du monde, qui devrait amener à tout le moins de sa part un effort de réflexion. La seule crainte que l’on puisse formuler est que la longueur de cet ouvrage et sa présentation austère ne lui ferment l’audience du très grand public, qu’il serait pourtant bien nécessaire d’éveiller. Est-il permis de souhaiter qu’un jour ou l’autre une version « facile » de cette étude voie le jour ?
Presses Universitaires de France, Paris, 1959.
André Fontaine

Tous les livres du mois

Partager cet article ×
S’inscrire.
En cliquant sur « S’inscrire », je reconnais avoir pris connaissance de la politique de confidentialité du Monde diplomatique et des droits dont je dispose sur mes données personnelles.

À la « une »
- Suivre nos actualités
- Lettre d'information
- Nous contacter
- Édition électronique
- Abonnements
- Réabonnement
- Abonnements institutionnels
- Qui sommes-nous ?
- Editions internationales
- Les amis du Diplo
- Mentions légales
- Politique de confidentialité
Le Monde diplomatique
- Journal audio
- Les blogs du Diplo
- Cartographie

Coexistence pacifique et géostratégie

- Référence bibliographique
Célérier Pierre. Coexistence pacifique et géostratégie. In: Tiers-Monde , tome 9, n°35-36, 1968. Coexistence pacifique. pp. 703-717.
DOI : https://doi.org/10.3406/tiers.1968.2460
www.persee.fr/doc/tiers_0040-7356_1968_num_9_35_2460
- RIS (ProCite, Endnote, ...)
LES TENSIONS IDÉOLOGIQUES ET LES CONFLITS

- Introduction
- I. Les causes de la division du monde en deux blocs
- Exercice : Je m'exerce sur les causes de la division du monde en deux blocs
- II- La guerre froide (1947-1953)
- Exercice : Je m'exerce sur la guerre froide
III. La coexistence pacifique et ses limites (1953-1962)
- Exercice : Je m'exerce sur la coexistence pacifique
- IV. La détente et ses limites
- Questions de synthèse
- Exercice : JE M'EXERCE
Définition : 1. Définition de la coexistence pacifique
L'expression coexistence pacifique est employée pour la première fois par Lénine pendant la Nouvelle Politique Économique (NEP). Elle sera reprise par Nikita Khrouchtchev en 1953. Elle exprime la nécessité pour les capitalistes et les communistes de vivre en paix sans exclure les compétitions entre les deux systèmes.
2. Les causes de la coexistence pacifique
La coexistence pacifique s'est instaurée à la faveur des éléments suivants :
Le changement d'hommes politiques aux EU et en URSS
En URSS après la mort de Staline le 5 mars 1953, ses successeurs montrent leur volonté de paix et de dialogue avec les dirigeants du bloc occidental. Nikita KHROUCHTCHEV en 1956 amorce le dégel par l'adoption d'une attitude souple à l'égard de l'Ouest. A l'intérieur, il entame la déstalinisation (dénonciation des dérives et œuvres de Staline). A l'extérieur, il privilégie désormais la compétition économique et scientifique. En effet, l'URSS avait besoin de rattraper son retard économique. Elle avait aussi besoin d'importer des denrées alimentaires pour satisfaire sa population. L'URSS ne met plus l'accent sur la compétition nucléaire.
De même aux EU, EISENHOWER qui succède à TRUMAN faisait preuve d'une volonté de modération vis à vis des soviétiques. En effet celui -ci était plus préoccupé par le bien- être de la population américaine que par la lutte contre le communisme.
L'équilibre de la terreur
Elle exprime l'égalité des pouvoirs de destruction. En effet, après 1945, les EU possédaient une réelle avance dans le domaine des armes stratégiques. Mais ils vont perdre progressivement cette avance par la mise au point par l'URSS de la bombe atomique (B.A.) en 1949, de la bombe H (B.H.)infiniment plus puissante en 1954 et surtout des fusées à moyenne portée et inter-continentales (ICBM, IRBM) en 1955 et 1957. De plus, le lancement du premier satellite artificiel (le Spoutnik) en octobre 1955, confirme que l'URSS est désormais capable de frapper le territoire américain par ses missiles.
Pour les EU, le choc est brutal. Ils lancent leur satellite le 4 octobre 1957 et procèdent à la construction de nombreux sous-marins atomiques.
L'équilibre nucléaire rend la guerre improbable d'où la célèbre formule du français Raymond Aron « paix impossible, guerre improbable ».
Parallèlement aux deux grands, se greffent l'ascension des pays tiers : Grande Bretagne (B.A. en 1951et B.H. en 1957), France (B.A. en 1960 et B.H. en1968), Chine Populaire (B.A. en 1964 et B.H. en1967), Inde (B.A. en 1974). Cet état de terreur pousse les Américains et les Soviétiques à s'entendre pour fermer le « club atomique ».
L'émergence du tiers monde [ 1 ]
En 1955 en Indonésie, la conférence de Bandung (Bandoeng) réunit 29 pays d'Afrique et d'Asie qui refusent de s'aligner derrière les EU et l'URSS. Ils forment un troisième bloc qui prône le non-alignement ou le neutralisme dans les relations internationales. Les leaders sont : Nehru en Inde, Nasser en Égypte et Soekarno en Indonésie.
3. Les manifestations de la coexistence pacifique
Cette période a été caractérisée par une série d'accords qui vont engendrer une baisse des tensions. On peut citer la signature de l'armistice de Pan Mun Jun en 1953 sur initiative des deux grandes puissances et de l'ONU.
Les occidentaux et les socialistes multiplient les contacts diplomatiques et se rencontrent ainsi à Berlin en 1954 et s'entendent sur le traité de paix avec l'Autriche. Le traité sera signé en 1955 et permettra le départ de toutes les troupes d'occupation de l'Autriche.
L'URSS reconnaît la RFA en 1955 et noue des relations diplomatiques avec le Japon. Ce qui permet à ce pays d'adhérer à l'ONU. En 1956, Khrouchtchev dissout le Kominform, signe de sa volonté d'ouverture. Dans la même année il se rend à Londres puis en 1959 il effectue une visite officielle aux EU et en 1960 à Paris. L'URSS adhère à l'UNESCO en1954. La Coexistence Pacifique a été également marquée par de nombreuses crises.
4. Une limite de la coexistence pacifique : la crise de Cuba
Depuis 1956 un jeune nationaliste Cubain, Fidel Castro et ses hommes combattaient le régime dictatorial pro-américain de François Batista. Le 1er janvier 1959, Fidel Castro soutenu par les guérilleros d'Ernesto Guevara (Che) renverse le régime de Batista et instaure la révolution. Il décide de nationaliser les terres et les usines dont la plupart appartenait aux entreprises américaines.
L'agression américaine
Le 15 avril 1961 les troupes américaines débarquent dans la « baie des cochons » pour appuyer un groupe de conservateurs cubains anti-Castristes. Mais elles échouent après trois jours de combats. Le débarquement qui avait pour but d'endiguer le communisme renforça davantage les relations entre Cuba et l'URSS. Cuba adhère dès lors au CAEM.
La crise des fusées de Cuba
En octobre 1962 éclate la crise des fusées. Selon les photographies prises par les avions espions U2, les Américains constatent que les Soviétiques installent à Cuba des rampes de lancement pour missiles à moyenne portée capables d'atteindre le territoire américain . De même les cargos soviétiques s'apprêtent à décharger des fusées et des bombes à Cuba. Le président américain John KENNEDY ne peut accepter cette menace directe sur son pays. Il exige le retrait immédiat de tous les dispositifs soviétiques à Cuba sous peine d'une riposte nucléaire et met en place un blocus naval de l'île de Cuba.
Le dénouement de la crise de Cuba
A la suite d'intenses négociations sous l'égide de l'ONU, Khrouchtchev s'incline et retire ses missiles. En contrepartie les américains promettent de lever le blocus, de ne pas attaquer Cuba et de démanteler leurs bases navale et aérienne en Turquie. Cette crise a révélé la crainte de l'utilisation de l'arme nucléaire. Elle est donc un moyen de dissuasion efficace contre une guerre directe.
Les EU renforcent leur embargo sur les produits cubains notamment le sucre.
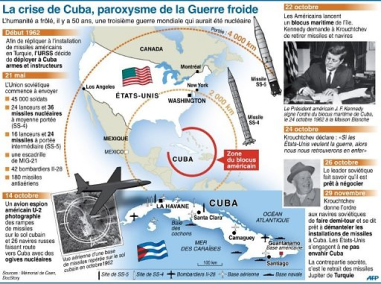
Il est l'ensemble des pays sous-développés d'Afrique, d'Asie et d'Amérique Latine qui enregistrent une certaine carence économique

- Se connecter à la Digital Toolbox
Déjà enregistré?
Pas encore enregistré, la guerre froide (1945-1989), la coexistence pacifique.
- Ressources (17)
- Partager Twitter Facebook Email
"La coexistence pacifique" dans Luxemburger Wort (14 mars 1953)
Caricature de efimov sur la coexistence pacifique (20 août 1955), nikita khrouchtchev lors du xxe congrès du pcus (1956), visite de nikita khrouchtchev aux états-unis (15 septembre 1959), allocution du sénateur john f. kennedy sur la visite de n. khrouchtchev aux états-unis (15 septembre 1959), "ce que je pense de la coexistence pacifique" dans etudes soviétiques (octobre 1959), rapport de nikita khrouchtchev devant le soviet suprême (31 octobre 1959), "coexistence pacifique" dans foreign affairs (janvier 1960), la position américaine lors de la rencontre de vienne entre john f. kennedy et nikita khrouchtchev (25 mai 1961), john f. kennedy et nikita khrouchtchev à vienne (1961).
- Ouvrir la transcription
Les deux K à Vienne par Yves Courrière (RTL, 3 juin 1961)
Interview accordée par le président john f. kennedy au journal soviétique izvestia (25 novembre 1961), caricature de behrendt sur les relations est-ouest (1962), caricature de abu sur la course aux armements (11 mars 1962), lettre de l'ambassadeur du luxembourg à moscou à pierre grégoire (moscou, 23 octobre 1968), les conditions d'utilisation du "téléphone rouge", "il a réussi sa vie mais manqué son oeuvre" dans le monde (14 septembre 1971).
Vous l’avez sans doute déjà repéré : sur la plateforme OpenEdition Books, une nouvelle interface vient d’être mise en ligne. En cas d’anomalies au cours de votre navigation, vous pouvez nous les signaler par mail à l’adresse feedback[at]openedition[point]org.

Français FR
Ressources numériques en sciences humaines et sociales
Nos plateformes
Bibliothèques
Suivez-nous
Redirection vers OpenEdition Search.
- Éditions de la Sorbonne ›
- Internationale ›
- Stratégie soviétique et chute du pacte ... ›
- Chapitre I. Pensée militaire soviétique...
- Éditions de la Sorbonne
Stratégie soviétique et chute du pacte de Varsovie
Ce livre est recensé par
Chapitre I. Pensée militaire soviétique et coexistence pacifique
Plan détaillé, texte intégral.
1 La prépondérance de l’Union Soviétique modèle tous les domaines au sein du bloc qu’elle forme avec ses alliés. Au premier plan, son idéologie fait de l’Union Soviétique une véritable théocratie marxiste dont le magistère conduit, entre autres, tout à la fois la pensée militaire comme la norme en matière de relations internationales, norme qui se traduit dans la deuxième partie du xx e siècle par le concept de « coexistence pacifique ».
2 Ces deux éléments en se combinant étroitement forment la base du système soviétique, allant jusqu’à structurer profondément l’organisation sociale et économique du bloc de l’Est. C’est sur eux que porte l’examen qui est de première importance.

L’essence et la nature de la guerre
3 Dès l’origine, l’Etat des Soviets fut confronté au problème de la guerre étrangère et civile, puis au duel qui l’opposa d’abord à l’Allemagne nazie, ensuite aux Occidentaux. Les dirigeants soviétiques étaient donc condamnés à se plonger dans les problèmes stratégiques. Cependant, outre la pratique, la théorie marxiste incitait les Soviétiques à étudier minutieusement les rapports de force et donc leur aboutissement éventuel sous forme d’affrontements armés. Ainsi, l’étude de la guerre fait partie intrinsèquement du marxisme qui se veut une science et que développa notamment Lénine, en continuation de Marx et d’Engels.
4 Pour les marxistes, le moteur de l’histoire est la lutte des classes dont la transposition dans l’arène internationale est la guerre, qu’elle soit civile ou étrangère. La guerre, en tant que phénomène social, ne peut disparaître donc qu’en conséquence de l’extinction de la lutte des classes, c’est à dire avec la victoire inéluctable du socialisme scientifique sur le capitalisme, ce qui permettra l’instauration définitive du communisme à l’échelon planétaire. S’il n’y a pas guerre, la menace n’en subsiste pas moins due à la nature même du capitalisme, essentiellement agressive, qui cherche à surmonter ses contradictions internes en déclenchant des conflits.
5 La guerre, comme tout phénomène social, répond à une science qui obéit à des lois, dont la découverte, grâce à la méthodologie marxiste-léniniste permet d’assurer la victoire.
6 Penser la guerre vise à la prévoir, soit pour la prévenir, soit pour la mener. L’école de pensée soviétique en matière militaire s’est efforcée de créer un modèle normatif qui puisse répondre à toutes les interrogations et servir de cadre aussi bien à la réflexion qu’à l’action. A cet effet, les Soviétiques ont procédé à l’établissement d’une classification des guerres et ont, parallèlement, organisé toutes les disciplines relevant de la question militaire en deux grands ensembles étroitement liés l’un à l’autre, la doctrine militaire et la science militaire.
7 La classification des guerres ne se cantonne pas à la théorie et à l’abstraction : elle est surtout un instrument prévisionnel appliqué à la pratique et se veut en prise avec la réalité. Les critères retenus se rapportent à quatre grands domaines : d’abord l’appréciation de la légitimité du conflit, puis son ampleur, ensuite son caractère technico-militaire et enfin, ce qui donne l’ossature de la classification marxiste-léniniste des guerres, sa nature socio-historique et socio-politique.
8 Le critère de légitimité d’une guerre se réfère intégralement à une distinction des guerres d’après leur caractère juste ou injuste opéré par Marx et reprise par Lénine 1 . Ce serait cependant un très grave contresens que de considérer le caractère d’une guerre définie par les Soviétiques comme juste ou injuste en terme de valeur morale. Il s’agit d’une appréciation politique obtenue par une analyse dialectique qui vise à définir un critère permettant de classer le conflit intrinsèquement, en fonction de son intérêt pour les causes confondues de l’Union soviétique et du prolétariat. C’est ainsi que « la compréhension des catégories de guerre englobe les différentes guerres justes et injustes selon un contenu politique concret en soi » 2 . Le critère de classification retenu implique logiquement que l’une des deux parties qui mène la guerre est un allié virtuel de l’URSS parce que son action favorise la cause soviétique à court ou à long terme.
9 Le critère de l’ampleur vise à déterminer l’échelle d’une guerre reprenant une distinction opérée par Engels entre guerres mondiale et locale. La distinction porte essentiellement sur le théâtre d’opération concerné, qui est géographiquement limité, en cas de guerre locale, et s’étendant à la planète en cas de guerre mondiale. Un type de guerre locale a été fourni par les conflits vietnamien, coréen, des Malouines et d’Afghanistan. La limitation porte sur l’aire géographique touchée et non sur les armements.
10 Le caractère technico-militaire de la guerre conduit à un troisième critère de discrimination qui, par bien des aspects, rejoint celui de l’ampleur de la guerre. Ce critère a essentiellement trait aux moyens militaires utilisés qui impriment leur marque distinctive au conflit en combinaison avec l’environnement.
11 La méthodologie soviétique appliquée à cette réflexion l’a traduite en une loi de la montée inéluctable aux extrêmes stipulant que, les intérêts vitaux d’une partie étant en cause, la partie ne peut qu’utiliser tous les moyens militaires à sa disposition et notamment l’arme nucléaire, sans aucune restriction, si elle la possède, ne serait-ce que dans le but de sa survie. La possibilité de l’emploi de l’arme nucléaire est donc le critère technico-militaire fondamental. Et une escalade vers l’extrême de la violence est tout à fait concevable dans un processus analogue à celui qui transforme une guerre locale en guerre mondiale. En effet, « il n’est pas exclu qu’une guerre commençant localement ne puisse se transformer en guerre mondiale, comme ce fut le cas avec la Seconde Guerre mondiale, et une guerre avec emploi des armes conventionnelles en une guerre avec utilisation de l’arme nucléaire 3 .
12 L’ossature de la classification des guerres est donnée par les critères socio-historique et socio-politique établis par Marx et Engels, puis repris par Lénine qui évidemment n’y avait pas porté les caractéristiques qu’ouvrait l’ère nucléaire. Cependant, les quatres types de guerre distingués ont été maintenus 4 .
13 Le premier type concerne l’affrontement entre les deux systèmes sociaux opposés. Ce sera inéluctablement une guerre de coalition opposant les Etats, expressions du socialisme et du capitalisme, guerre qui prendra obligatoirement la forme d’une guerre mondiale nucléaire, puisqu’il y va de la survie de l’un des camps et que ces Etats sont en possession d’armes nucléaires. Le camp perdant cessera d’exister en tant que structure sociale organisée.
14 Le deuxième type de guerre codifie « les guerres civiles entre le prolétariat et la bourgeoisie ou les masses populaires et les forces réactionnaires soutenues par les impérialistes d’autres pays » 5 . Le conflit afghan répond, entre autres, à ce type de guerre dans laquelle l’URSS et le camp socialiste se doivent de soutenir les forces se réclamant du socialisme, au nom du concept de l’internationalisme prolétarien 6 , ce qu’elles ont fait militairement à partir de décembre 1979. L’engagement soviétique fut, cependant, reconnu par la perestroïka comme une erreur.
15 Troisième type de guerre, les guerres de libération nationale qui mettent aux prises les peuples dominés luttant contre des invasions perpétrées par des Etats impérialistes. Se classent dans ce type de guerre, entre autres, les guerres engagées par les Français contre les Espagnols en 1807 et contre les Russes en 1812, comme l’intervention des forces de l’Entente contre les Soviétiques en 1918 et la lutte des Français contre les Allemands de 1940 à 1945. A l’époque contemporaine, ce type de guerre est surtout représenté par les conflits menés par les Etats colonialistes ou néo-colonialistes. Les guerres de libération nationale n’opposent pas nécessairement le prolétariat à l’impérialisme, notamment en ce qui concerne les guerres coloniales. Si l’impérialisme est toujours partie prenante, son adversaire peut très bien être une bourgeoisie nationaliste ; en ce cas intervient avec force la nécessité de déterminer le caractère juste ou injuste d’une telle guerre. C’est ainsi que se pose aux Soviétiques le problème de la Libye dans le courant des décennies soixante-dix et quatre-vingt, car il est établi que le dirigeant libyen, Khadaffi, n’est en rien marxiste-léniniste.
16 Dernier type de guerre, les affrontements entre impérialistes, entre nations capitalistes, n’ont pas disparu. Cette catégorie de conflits, la plus fréquente dans l’histoire, a été illustrée notamment par les Première et Seconde Guerre mondiales opposant les coalitions dirigées d’une part par l’Entente comprenant la Russie impériale et par l’Allemagne, puis par le Royaume-Uni et la France et par l’Allemagne nationale-socialiste en 1939.
17 L’ossature procurée par les critères socio-politique et socio-historique forme une véritable matrice qui permet l’interaction de la combinaison des autres critères.
18 Le danger qu’offre cette classification codifiée des guerres est un automatisme qui amène un engagement mécanique dans un conflit. Pour une large part, c’est ce type d’approche qui conduisit l’URSS à entrer dans la guerre d’Afghanistan.
19 Toutes les questions relevant du domaine militaire, de près ou de loin, sont incorporées dans un ensemble de disciplines, de systèmes rigoureusement codifiés. Ce grand ensemble se subdivise en deux sous-ensembles : la doctrine militaire et la science militaire.
20 Par doctrine militaire, les Soviétiques entendent « un système de points de vue, qu’adopte l’Etat en un temps donné, sur les buts et le caractère de la guerre potentielle, sur sa préparation par le pays et les forces armées, et aussi sur les modalités de la mener » 7 . Quelles que soient les formulations employées, la définition ne diffère que par des détails infimes et détermine le même concept et la même unité dans la pensée 8 . Il s’agit d’un corps de doctrine résolument prévisionnel. Tout Etat, qu’il soit capitaliste ou marxiste, a une doctrine militaire, mais « ce qui constitue la pierre angulaire de la doctrine militaire de tout Etat, c’est la conception qu’elle comporte de l’essence de la guerre » 9 . Les questions essentielles que pose la doctrine militaire et auxquelles elle apporte une réponse relèvent de la détermination de l’ennemi et, en cas d’une coalition, de l’ennemi principal dont le traitement demande la concentration des efforts, du caractère de la guerre potentielle et de ses objectifs comme des problèmes qu’elle soulève, des caractéristiques et du volume des forces armées nécessaires pour résoudre les problèmes posés, de la préparation à la guerre des armées et du pays et des moyens indispensables pour mener la guerre jusqu’à son aboutissement victorieux. Toute une série de paramètres, en interaction perpétuelle, compose la doctrine militaire, ce qui fait que « la doctrine militaire soviétique, surtout dans sa partie militaire, ne reste pas immuable » 10 .
21 La transformation essentielle intervenue à partir de la perestroïka de 1986 réside dans le but premier assigné à la doctrine militaire : prévenir la guerre et non plus obtenir la victoire. Ce n’est qu’en cas d’échec de la prévention de la guerre que la victoire est l’objectif primordial. Et encore, la victoire se définit-elle théoriquement par le rejet de l’agression et non plus par l’anéantissement de l’ennemi.
22 Cette doctrine se divise « en deux groupes de questions liés réciproquement, politiques et militaires » 11 , formant « deux parties étroitement unies et interdépendantes, à savoir les domaines socio-politique et militaro-technique » 12 .
23 « Cependant la partie socio-politique occupe une position dirigeante, déterminante » 13 , car elle étudie au premier chef les buts politiques de la guerre, la base économique et sociale de la nation et de l’ennemi, ce qui détermine le potentiel dans lequel s’inscrit la constitution et le maintien au niveau voulu des forces armées.
24 Les aspects militaro-techniques de la doctrine militaire soviétique s’attachent plus précisément à l’édification de l’appareil militaire dans sa globalité, à la constitution des forces armées comme à leur dotation en moyens et aux procédés de préparation et de conduite éventuelle des opérations.
25 La doctrine militaire soviétique pose ainsi des bases intangibles à partir desquelles la science militaire doit s’élaborer. En premier lieu, l’URSS ne se veut pas agressive. En second lieu, s’il y a guerre, le but est non seulement de repousser l’agression, mais encore d’anéantir l’adversaire par une victoire militaire totale, ce qui ne peut être obtenu que par l’offensive. A ce sujet, il est nécessaire de souligner qu’il n’y a aucune contradiction en termes militaires entre une doctrine défensive, non agressive, et une stratégie offensive. Reste à définir exactement ce qu’est l’agression par contre ! La perestroïka définit l’agression par l’attaque. Mais peut-on attendre cette attaque sans la prévenir, avec toutes les erreurs d’appréciation que comporte un tel concept ? Dernier point, la surprise joue un rôle primordial.
26 La science militaire est « un système de connaissances sur le caractère et les lois de la guerre, la préparation des forces armées et du pays à la guerre et les procédés de sa conduite » 14 . Tous les stratèges soviétiques s’appuient sur le même concept 15 pour établir une division de la science militaire en deux grandes branches ou rameaux. En premier lieu, il s’agit de l’étude et de la réalisation concrète de l’organisation du pays en vue de la guerre, tant en ce qui concerne les aspects économiques que politiques et les institutions proprement militaires telles que la mobilisation, la défense civile, les transports, l’esprit de défense... La deuxième branche a trait à la théorie et à l’exécution de la conduite de la guerre et des opérations militaires. Il s’agit de « l’art militaire » qui se subdivise en trois disciplines, stratégie, art opératif et tactique, qui toutes trois englobent des procédés de conduite, de commandement, d’instruction et d’éducation des troupes. Il s’agit bien ici d’art, puisqu’intervient le facteur humain. La connaissance des lois de la guerre et de ses principes d’application n’est pas suffisante, encore faut-il une application correcte et la détermination opportune des circonstances à l’occasion desquelles jouent d’une manière précise ces lois de la guerre. Le talent et l’expérience du stratège, de l’homme de guerre, opèrent donc pour une partie non négligeable.
27 La stratégie « occupe la première place dans l’art militaire » 16 , « en représente le domaine supérieur » 17 . « Partie constituante de l’art militaire et son domaine supérieur, elle embrasse la théorie et la pratique de la préparation des troupes à la guerre » 18 .
28 L’art opératif découle de la stratégie et « occupe une place intermédiaire entre la stratégie et la tactique » 19 . Il traite des opérations des différentes armées, des groupements importants de forces sur des théâtres d’opérations considérés isolément. Cette conception recouvre celle qu’avait un penseur militaire français du xviii e siècle, Guibert, lorsqu’il parlait de « grande tactique » 20 .
29 De même que l’art opératif est subordonné à la stratégie, la tactique l’est à l’art opératif en englobant « la théorie et la pratique du combat des unités, formations et Grandes Unités » 21 dont le niveau se situe à celui de la division et au dessous, c’est-à-dire concernant le commandement d’une dizaine de milliers de combattants et moins.
30 En cherchant une comparaison avec les concepts occidentaux et à condition de faire abstraction de la méthodologie comme de l’existence de lois de la guerre, le concept soviétique de doctrine militaire recouvre à peu près la compréhension qu’ont les Occidentaux, et notamment les Français, du contenu de la politique de défense allié à celui d’une polémologie prévisionnelle. Quant à la stratégie militaire, pour reprendre la définition occidentale utilisée par le général Beaufre 22 , elle est l’art de combiner les forces en vue d’obtenir le résultat déterminé par une politique de défense. Et dans cette conception, la tactique est l’art de combiner les armes et les armées en vue d’atteindre un objectif concret déterminé par la stratégie militaire. Pour les Soviétiques, stratégie militaire et tactique combinent bien les mêmes éléments, mais la combinaison en question ne relève pas d’un art : elle est une science qui impose à l’homme de guerre d’appliquer des lois donnant la victoire.
31 Le concept soviétique, rigoureusement codifié, d’une massive cohérence, sera nécessairement moins sujet à des contingences que ses homologues occidentaux. De ce fait, il est marqué du sceau de la continuité, mais aussi de la lourdeur.
32 L’architecture de la pensée militaire soviétique dans son agencement, sa méthodologie et sa codification présente un hermétisme impénétrable sans l’appréhension de ses fondements marxistes. L’école de pensée militaire soviétique se veut scientifique, pétrie de certitudes, fait référence à des lois qui imposent leur déterminisme, procède à la découverte de nouvelles lois appliquées encore plus directement au domaine militaire, renforçant ainsi ce déterminisme au point d’enserrer tout concept, quel que soit son niveau, dans un système clos et rigoureusement codifié. Le mérite de la démarche est de promouvoir une absolue cohérence et le désavantage une rigidité indéniable à laquelle les Occidentaux ne sont pas habitués et les déroute.
33 Bien souvent, les Occidentaux, ayant tendance à prêter à leurs adversaires leurs propres concepts ou à créditer l’ennemi d’une stratégie qu’ils voudraient lui voir utiliser et non de celle qu’il a, rejettent les fondements marxistes du système militaire soviétique, parce qu’ils leur paraissent relever d’une idéologie totalement inutile en la matière. La rigidité de la pensée militaire soviétique la rend alors d’autant plus obscure.
34 Le marxisme-léninisme est peut-être un habillage, mais sa langue, sa méthodologie, sa façon de raisonner ont imprégné la société soviétique au point de lui donner une nouvelle nature, un nouveau vocabulaire, une nouvelle manière de s’exprimer. Lénine est devenu une référence normale au point de n’être plus ressentie comme telle. Lorsque dans sa lettre au Comité central du Parti polonais, le Comité central du Parti soviétique, traitant de la situation polonaise, en 1981, reprend en conclusion les paroles du Secrétaire général du CC du PCUS au XXVI e congrès – « Nous ne laisserons pas porter atteinte à la Pologne socialiste et n’abandonnerons pas au malheur un pays frère » 23 – les Soviétiques et même Brejnev sont-ils conscients qu’il y a là répétition d’une formulation de Lénine prononcée dans des circonstances semblables alors que les forces contre-révolutionnaires blanches marchaient sur Petrograd, à savoir, « Nous ne nous abandonnerons pas au malheur » 24 ? Par contre, il est certain que le Secrétaire général Gorbatchev avait parfaitement conscience qu’il reprenait la même démarche que Lénine, avec son décret sur la paix de 1917 adressé aux peuples du monde par dessus les gouvernements, en s’adressant le 15 janvier 1986 aux opinions publiques mondiales avec son plan de désarmement. Les deux démarches, d’ailleurs, eurent le même insuccès. Qu’il y ait depuis les années soixante une baisse de la ferveur idéologique à l’Est, et que l’URSS n’y fasse pas exception, est un point acquis dont le constat a été dressé par les différents congrès du parti communiste sans faire mention de l’effondrement des partis communistes intervenus parmi les alliés du pacte de Varsovie, dans le courant de l’été 1989. Et chaque congrès a été l’occasion d’appeler le Parti à retrouver et à répandre une rigueur marxiste, à faire preuve de militantisme. Quoi qu’il en soit, la baisse de l’idéologie ne met pas en cause les comportements acquis et surtout les systèmes de raisonnement dans lesquels baigne toute réflexion en Union soviétique, entre autres, la réflexion stratégique. Les Soviétiques, quant à eux, considèrent leur concept militaire et leur raisonnement stratégique comme des instruments hors pair, ce qu’a démontré leur victoire de 1945.
35 L’école de pensée militaire soviétique a gagné les pays du pacte de Varsovie et régit l’ensemble de leurs forces armées. Cette pensée militaire est un produit du marxisme, dont la valeur est attestée par la réussite en la matière des Soviétiques, et se distingue radicalement de ce que peuvent concevoir les Occidentaux, à la lumière des prévisions d’Engels écrivant que l’Etat prolétarien « aura son expression particulière dans l’art militaire et créera sa méthode particulière nouvelle » 25 . Toute la vision historique du Pacte se retrouve dans cette conception, puisque, suivant Engels toujours, « la nouvelle science militaire sera un produit des rapports sociaux nouveaux, aussi nécessaire que la science de la guerre créée par la Révolution et Napoléon et qui était un résulat inévitable des nouveaux rapports engendrés par la Révolution » 26 . Les mêmes causes produisant les mêmes effets dans des circonstances semblables, le concept militaire marxiste-léniniste doit être le gage de la victoire ou de l’absence de guerre.
36 Le nouveau mode de pensée politique de la perestroïka, a, cependant, introduit un nouvel élément de taille. Contrairement à un concept établi, depuis 1917, uniquement sur un rapport de forces militaires, « la sécurité de l’URSS doit être garantie en premier lieu par des moyens politiques comme partie intégrante d’une sécurité générale et égale dans le processus de démilitarisation, de démocratisation et d’humanisation des relations internationales, en s’appuyant sur le prestige et les possibilités des Nations unies » 27 . C’est « l’analyse sérieuse de la conjoncture internationale qui a conduit l’URSS à adopter un nouveau mode de pensée » 28 . Il n’en demeure pas moins que les moyens politiques garantissant la paix ne sont pas exclusifs de moyens militaires suffisants assurant une défense efficace 29 .
37 En tout état de cause, la perestroïka ne pouvait pas manquer d’influer profondément sur la pensée militaire soviétique, non seulement dans son application, mais également dans son essence même.
La définition du concept de coexistence pacifique
38 Le concept de coexistence pacifique initié par Staline, mis en œuvre par Khrouchtchev dans le courant des années cinquante, a été progressivement affiné par la suite. La formulation définitive a été arrêtée à la suite des XXIV e et XXV e congrès du Parti, en 1971 et en 1976, et depuis lors, les instances dirigeantes soviétiques s’y sont constamment référées sans aucune remise en cause de fond. C’est cette même formulation qui a été reprise par la Constitution de 1977, devenant ainsi loi fondamentale de l’Etat soviétique.
39 Le point de départ instituant une coexistence pacifique entre pays à régimes socio-politiques différents est la prise en compte d’une situation internationale et d’un équilibre du rapport des forces permettant, aux yeux des Soviétiques, d’éviter l’affrontement suprême entre l’Est et l’Ouest. La guerre n’est donc pas inéluctable, mais reste possible.
40 La validité du concept de coexistence pacifique exige l’instauration de principes mutuellement acceptés qui comprennent notamment, à la base, celui « de relations entre Etats à régimes sociaux différents supposant le refus de l’emploi de la force militaire ou de la menace de son emploi comme moyens de résoudre les questions internationales en litige » 30 . Dès l’énoncé du principe de base apparaît ainsi une opposition avec l’Ouest, car par « menace d’emploi de la force militaire », les Soviétiques entendent l’application de la stratégie de dissuasion et notamment du concept de « flexible response » américain prévoyant toute une gradation de ripostes, perçues comme autant de menaces. Les litiges doivent être réglés par le canal de négociations, mais en aucun cas à l’aide « de tentatives visant à promouvoir une politique à partir de positions de forces » 31 , qualificatif soviétique de la stratégie de dissuasion.
41 Les autres bases sont la prise en compte réciproque des intérêts, le droit reconnu à chaque Etat de résoudre ses questions internes sans ingérence, d’où découle la stricte observation de la souveraineté et de l’égalité des droits de chaque Etat. Sont stipulées de même l’intégrité territoriale des Etats et l’inviolabilité de leurs frontières. La concrétisation de cette partie du concept a été réalisée par les clauses de la première partie de l’acte final de la conférence d’Helsinki, en 1975, proclamant l’intangibilité des frontières issues de la Seconde Guerre mondiale. D’une manière plus générale, cette conférence d’Helsinki devait être le triomphe de la coexistence pacifique.
42 A partir d’une renonciation commune à la force et d’une acceptation mutuelle de régimes socio-politiques différents, il est possible d’établir une coopération économique, technologique et culturelle, avantageuse pour toutes les parties. Ce dernier point intéressait particulièrement les Soviétiques, car il permettait des transferts de technologie occidentale afin de combler les créneaux que la planification de la recherche scientifique et technique pouvait ainsi, sciemment ou non, laisser ouverts. La deuxième partie de l’acte final d’Helsinki, ce que les Occidentaux appellent la deuxième corbeille, a prévu l’extension des échanges économiques, tandis que la troisième corbeille avait trait aux échanges culturels et à la libre circulation de l’information et des idées.
43 L’instauration de la coexistence pacifique, surtout après la signature du traité d’Helsinki, amena effectivement une augmentation des relations commerciales avec l’Est, malgré les entraves que posait une règlementation spécifique éditée par l’OTAN et interdisant le transfert de technologies de pointe susceptibles de favoriser l’effort de défense de l’Est. L’OTAN voyait dans cet aspect de la coexistence pacifique un système permettant aux Soviétiques de pallier leurs déficiences.
44 De leur côté, les Soviétiques estiment qu’il convient de « délimiter strictement deux problèmes étroitement liés, mais toutefois distincts : celui de la coexistence du socialisme et du capitalisme et celui de la coexistence pacifique des pays socialistes et capitalistes » 32 . La distinction est fondamentale, car la coexistence pacifique n’intéresse que les relations inter-étatiques. En effet, « dans le domaine idéologique, il ne peut y avoir de coexistence pacifique. Aucun compromis n’est possible entre les idéologies communiste et bourgeoise et la lutte entre elles est inévitable » 33 . Ceci est d’autant plus vrai qu’aux yeux des Soviétiques, l’ennemi mène une action subversive permanente en s’appuyant sur la troisième corbeille d’Helsinki, en violant donc la règle de non-ingérence.
45 Le refus soviétique de transiger avec le marxisme-léninisme marque donc qu’il n’est pas question d’un amoindrissement du conflit avec le capitalisme, mais de son règlement par des moyens pacifiques. La coexistence pacifique mène à la détente dans le domaine international, mais « il est, en effet, parfaitement clair que la détente et la coexistence pacifique concernent les rapports entre Etats » 34 . Le conflit demeure dans sa totalité parce que « la détente n’abolit et ne peut abolir ou modifier en aucune façon les lois de la lutte des classes ». Les Soviétiques n’acceptent pas plus de se renier qu’ils ne modifient leur vision sur les causes permanentes du conflit, dues selon eux à l’existence même du capitalisme. « Personne ne peut escompter qu’en raison de la détente les communistes accepteront l’exploitation capitaliste ou que les représentants des monopoles deviendront partisans de la révolution ». Les réformes introduites par Gorbatchev, à partir de 1985, n’ont en rien modifié cette optique de base, mais vont aboutir à une perversion du système.
46 La coexistence pacifique pose un état de non-guerre entre l’Est et l’Ouest, entre le socialisme et le capitalisme. « La coexistence pacifique sert de base à la compétition pacifique entre le socialisme et le capitalisme à l’échelle internationale et se révèle une forme spécifique de la lutte des classes entre eux » 35 . Ce dernier élément de définition de la coexistence pacifique perçue comme une forme spécifique de la lutte des classes devait perdre sa validité au cours des années quatre-vingt sans cependant gommer le conflit inhérent à l’existence des deux systèmes socio-politiques. En effet, prenant de plus en plus en compte l’aspect suicidaire que représenterait une guerre nucléaire généralisée, le nouveau cours politique initié par la perestroïka du Secrétaire général, M. Gorbatchev, a déterminé une limite à l’affrontement entre l’Est et l’Ouest. La guerre n’est pas inéluctable, mais reste toujours possible. Cependant, cette possibilité de guerre, estiment les Soviétiques, dans le courant des années quatre-vingt, ne peut rationnellement aller jusqu’à la conflagration nucléaire générale sous peine d’un saut suicidaire dans l’inconnu que représente l’éventualité de l’anéantissement de l’humanité. Peut-il être donc encore question de vainqueur à l’issue d’un tel conflit ? Il existe donc un seuil à ne pas franchir dans l’affrontement, celui de la guerre nucléaire généralisée, même en tant qu’éventualité. C’est pourquoi, « classique en son temps, le précepte de Clausewitz selon lequel la guerre est la poursuite de la politique par d’autres moyens est devenu irrémédiablement démodé » 36 . Il en découle une nouvelle dialectique de la force et de la sécurité qui « se déduit de l’impossibilité d’une solution guerrière – ou plutôt nucléaire – aux différends internationaux » 37 . Implicitement, M. Gorbatchev met partiellement en cause la pensée de Lénine qui reprenait la démonstration sur les liens de la continuité entre guerre et politique de Clausewitz. Certes, Lénine donnait un sens plus général et marxiste à l’optique de Clausewitz, mais il n’en demeure pas moins que la continuation de la politique par la guerre se heurte au fait nucléaire, si l’aboutissement doit être l’affrontement suprême. Le but politique poursuivi par une guerre nucléaire généralisée est irrationnel en ayant comme conséquence l’anéantissement des vainqueurs et des vaincus. C’est pourquoi, « des changements, dans l’esprit de cette nouvelle perspective, ont été introduits dans la dernière édition du programme du PCUS adopté lors du XXVII e congrès du Parti. En particulier, nous n’estimons désormais plus possible d’y retenir la définition de la coexistence pacifique entre Etats dotés de systèmes sociaux différents comme une forme spécifique de la lutte des classes » 38 , à la différence du programme du Parti de 1976. Il n’en demeure pas moins que la première définition du programme du Parti de 1976 reste valable : la coexistence pacifique continue à servir de base au conflit entre le socialisme et le capitalisme. Cependant, ce conflit, au lieu d’être armé, se traduit par une compétition pacifique dans tous les domaines. « La compétition idéologique, économique et politique entre les pays capitalistes et socialistes est inévitable » 39 . Et le garant de la coexistence pacifique, aux yeux des Soviétiques, dans une première version, reste une puissante capacité défensive apte à anéantir les Occidentaux ! Dans une deuxième version, adoptée à la fin des années quatre-vingt, ce garant est une capacité rationnellement suffisante pour repousser une attaque !
47 En interdisant l’affrontement direct généralisé de bloc à bloc, la coexistence pacifique laisse planer l’éventualité beaucoup plus crédible de conflits limités, de guerres locales selon la terminologie soviétique, dont le champ d’action européen ne peut être exclu. En outre, la réalité des faits atteste l’existence de ces conflits limités.
48 Pour l’URSS, il ne saurait y avoir qu’une seule alternative dont les termes ne varient pas, « coexistence pacifique ou guerre catastrophique : c’est l’unique choix offert par l’histoire » 40 , autrement dit, désormais, « il n’y a pas d’alternative raisonnable à la coexistence pacifique » 41 . Or, comme l’adversaire se refuse à rejeter l’emploi ou la menace d’emploi de la force, il reste à imposer la coexistence pacifique. « C’est pourquoi, l’une des plus importantes conditions de la mise en exécution de la coexistence pacifique se révèle être la consolidation de la puissance de l’économie et de la défense des pays de la communauté socialiste » 42 . L’autre terme de l’alternative, trouvé par les réformistes de M. Gorbatchev, à la fin des années quatre-vingt, consistera à créer des conditions politiques convenables au règlement pacifique des conflits. Cependant, jamais il ne sera question d’un désarmement unilatéral allant au dessous d’un seuil garantissant la défense certaine de l’URSS. B. Eltsine, à la tête de la Russie, héritière de l’URSS, n’adoptera pas une autre option.
49 Tant qu’ils se refusent à renoncer au soutien à l’expansion du « mouvement révolutionnaire mondial », selon leurs propres termes, les Soviétiques, objectivement, provoquent des craintes et des réactions qui, du côté occidental, peuvent aller jusqu’à des interventions armées susceptibles de dégénérer en des conflits plus larges. Il ne peut en découler qu’un regain de tension, même en posant en préalable que les Soviétiques ne sont pas à l’origine des soulèvements dans le Tiers monde. Le concept de coexistence pacifique contient ainsi en son sein une première série de ferments de contradiction.
50 Une deuxième série de ferments de contradiction s’inscrit dans les relations même que prévoit la coexistence pacifique avec les Etats à économie de marché. Sachant la victoire finale du communisme inévitable, l’Union soviétique repousse la guerre générale comme moyen de règlement du conflit et vise donc à maintenir une paix dont, selon elle, le principal garant est sa puissance militaire. « Le fait que sur notre planète n’ait pas éclaté une guerre de missiles nucléaires est dû avant tout à l’existence de l’Union soviétique, de l’amitié des Etats socialistes et de leur puissance capable d’arrêter l’agresseur » 43 . La compétition pacifique entre les deux systèmes socio-politiques peut dégénérer en guerre ouverte, pour peu que le camp socialiste baisse sa garde. Il y a là un procès d’intention que les Soviétiques assoient sur leur analyse marxiste-léniniste estimée scientifiquement fondée. Mais, les Occidentaux, parce qu’ils ne sont pas marxistes-léninistes, ne peuvent les suivre dans cette logique, par définition. Il en résulte que la seule solution à la situation marquée par une confrontation armée sans guerre serait le désarmement. Celui-ci est limité d’une part par la gigantesque méfiance réciproque qui amène les deux camps à dresser l’un contre l’autre des réquisitoires, d’autre part par l’existence des guerres de libération nationale. Cependant, d’après les Soviétiques, la coexistence pacifique conduit à des accords de limitation des armements, tels ceux conclus, dans le courant des années soixante-dix, sous la forme des traités ABM, SALT-1 et SALT-2, par prise en compte de l’intérêt réciproque des parties, dès qu’elles ont admis l’inanité d’une course aux armements ne pouvant rompre une parité instaurée. De même, est possible un abaissement du niveau des armements, à savoir donc l’engagement d’un processus de désarmement, tel celui concrétisé par le traité de Washington de 1987 sur le démantèlement des systèmes nucléaires à portée intermédiaire. Dans ce cadre, il s’avère « qu’il n’est plus possible de l’emporter ni dans la course aux armements ni dans la guerre même » 44 . Il en découle « qu’en ce siècle, une véritable sécurité, égale pour toutes les parties, est garantie non par le niveau maximum, mais par le niveau minimum de la balance stratégique dont il est nécessaire d’exclure entièrement l’arme nucléaire et les autres types d’armes de destruction massive ». La coexistence pacifique reste donc un rapport conflictuel dans tous les domaines, y compris celui du désarmement, puisqu’il s’agit au premier chef de persuader l’adversaire qu’il ne peut être le plus fort. A cette effet, « la puissance défensive de l’URSS se maintient à un niveau qui permet de défendre de façon sûre le travail pacifique, la vie pacifique des Soviétiques ». Les forces armées de l’URSS et de ses alliés du pacte de Varsovie restent donc, quoiqu’il en soit, le garant de la coexistence pacifique.
51 En tout état de cause, la coexistence pacifique n’a pas apporté aux Soviétiques tous les fruits qu’ils en escomptaient. La conférence d’Helsinki de 1975 devait en être un parachèvement. Or, la troisième corbeille, celle des droits de l’homme, a amené l’ouverture de manœuvres occidentales jugées subversives. Aux droits socialistes de l’homme, tels que les conçoivent les Soviétiques, axés sur la satisfaction de besoins collectifs et sociaux, s’oppose la conception individualiste des Occidentaux qui rejette toute entrave à la liberté politique et d’expression et repousse donc catégoriquement jusqu’au principe d’un parti unique ou ayant un rôle dirigeant. Les Soviétiques, entre autres, mettent en exergue la liberté économique de l’homme, la garantie d’un emploi sans laquelle, selon eux, le mot même de liberté est vidé de tout sens et établissent la comparaison avec les sociétés occidentales où le chômage est admis. Or, en Union soviétique, le chômage est inconnu. « L’Etat s’inquiète d’assurer le plein emploi. Même une personne licenciée pour paresse ou manquement à la discipline du travail doit se voir offrir un autre travail » 45 . Dans un autre registre, l’échelle des revenus est beaucoup plus resserrée à l’Est qu’à l’Ouest, ce qui amène une plus grande égalité. C’est pourquoi, « l’égalisation des salaires reste également une constante de notre vie quotidienne » 46 . Au total, la société soviétique bénéficie d’un degré élevé de protection sociale inconnu chez les Occidentaux, degré de protection qui va jusqu’à ce que « les enfants du dernier des parasites ne seront pas abandonnés à leur destin ». Il n’en demeure pas moins qu’en mettant en avant leur concept individualiste des droits de l’homme et en s’appuyant sur la troisième corbeille du traité d’Helsinki, les Occidentaux ont provoqué dans les pays de l’Est des remous. C’est ainsi qu’en URSS et dans les pays du pacte de Varsovie se sont créés « des comités pour le respect du traité d’Helsinki » qui ont reçu un soutien occidental et dont la simple existence était une contestation du régime socio-politique de l’Est. La question des droits de l’homme a même permis de cristalliser une opposition. C’est ainsi que, le 10 décembre 1987, à l’appel du mouvement tchécoslovaque « Charte 77 », un millier de personnes a manifesté publiquement dans les rues de Prague afin de célébrer la journée des droits de l’homme des Nations unies 47 .
52 La question du plein emploi et de l’égalitarisme sera au centre de la contestation envers le régime instauré par B. Eltsine en 1992.
53 Point positif, la tension diminuant, la détente avait conduit à une normalisation des relations avec l’Allemagne fédérale, marquée par une série de traités et par la conclusion des accords sur Berlin. En revanche, c’est dans le domaine des échanges de technologie que les Soviétiques estimèrent avoir subi l’échec le plus fort dans la pratique de la coexistence pacifique. La deuxième corbeille du traité d’Helsinki prévoyait expressément une augmentation des échanges, ce à quoi avaient tenu tout spécialement les Soviétiques. Ils en espéraient le rattrapage de plusieurs retards dans les technologies avancées où les Occidentaux étaient particulièrement compétitifs. Des secteurs de recherche avaient été totalement abandonnés : « Nous avons même renoncé à certaines de nos recherches et de nos développements technologiques dans l’espoir que, grâce à la division mondiale du travail, il serait moins onéreux d’acheter certains matériels que de les fabriquer nous-mêmes » 48 . Or, cette « naïveté a été durement sanctionnée ». Les Occidentaux et l’OTAN, sous influence américaine notamment, renforcèrent la règlementation « COCOM » qui interdisait le transfert à l’Est de produits sensibles intéressant de près ou de loin la défense ou les technologies avancées.
54 La relance de la course aux armements, intervenue au début de la décennie quatre-vingt, ne devait pas mettre en question la coexistence pacifique, les deux camps se gardant bien de tout geste trop hostile qui puisse provoquer l’ouverture d’une guerre apocalyptique.
55 La coexistence pacifique traduit bien ainsi un état de non-guerre, caractérisé par la persistance du conflit qui prend diverses formes avec une amplitude plus ou moins grande. Cette situation s’explique parfaitement par la genèse de la coexistence pacifique dans ses différentes phases.
La genèse de la coexistence pacifique : l’exportation armée de la révolution et le socialisme dans un seul pays
56 Dès avant leur prise de pouvoir, les révolutionnaires marxistes, au sein du parti ouvrier social-démocrate de Russie, partisans de la ligne de Trotsky comme partisans de la ligne de Lénine, jugeaient inévitable une lutte armée les opposant à leurs adversaires de classe : non seulement dans le cadre d’une guerre civile après une prise de pouvoir qui ne pouvait se produire que par la violence, mais encore dans l’arène internationale contre les Etats capitalistes cherchant à étouffer par la force la première traduction étatique du socialisme. Un deuxième élément d’analyse rendait inévitable le conflit armé, conformément à la classification des guerres établies par Marx et Engels. Le marxisme-léninisme prouve que l’exacerbation des contradictions internes au système capitaliste le pousse à son stade suprême, l’impérialisme. Celui-ci n’a d’autre ressource pour surmonter la concurrence internationale à laquelle sont obligées de se livrer les nations capitalistes que de provoquer la guerre, soit contre une autre nation capitaliste, soit contre un Etat socialiste, soit contre les deux. Quel que soit le cas de figure et l’approche de l’analyse, la guerre était donc inévitable. Le parti ouvrier social-démocrate de Russie, après son VI e congrès de juillet 1917 et avec son accession au pouvoir devenu le parti communiste bolchévique de Russie, conserve entièrement son point de vue.
57 C’est cette analyse qui devait amener Lénine à énoncer, en 1919, que « tant que le capitalisme sera aux côtés du socialisme, ils ne pourront vivre en paix, l’un des deux devra écraser l’autre » 49 . L’échec des propositions de paix contenues dans le « décret sur la paix » promulgué en novembre 1917, comme la guerre civile et l’intervention étrangère, tendaient à confirmer aux yeux des Soviétiques la justesse de leur analyse sur le caractère inévitable de la guerre tant qu’existerait le capitalisme. La conclusion de la paix de Brest-Litovsk, le 3 mars 1918, toute désastreuse qu’elle fut pour la Russie des Soviets, visait à obtenir une suspension d’armes, un armistice momentané, qui puisse permettre de renforcer le premier Etat socialiste lors de la phase de son éclosion. L’analyse soviétique à ce sujet n’a jamais varié. Dans le courant des années quatre-vingt, les Soviétiques estimaient toujours que « les termes de ce traité, tel que l’Allemagne nous l’imposait, étaient pour nous, comme Lénine l’a dit, honteux et ignobles » 50 . Malgré toutes les oppositions, le traité fut signé sur l’insistance de Lénine à qui les Soviétiques donnent toujours raison, « car il avait été guidé par une vision à long terme, plaçant ce qui était essentiel au dessus de ce qui était transitoire. La Révolution fut sauvée ».
58 La signature du traité de Brest-Litovsk ne fut donc, en aucun cas, la concrétisation de la volonté de paix affirmée par le « décret sur la paix » de novembre 1917, mais une manœuvre circonstancielle dictée par le poids des événements, en l’occurrence l’accentuation d’une défaite militaire irrémédiable qui ne pouvait être évitée autrement. D’ailleurs, dès que cela leur fut possible, les Soviétiques dénoncèrent le traité de Brest-Litovsk et ils n’attendirent à cet effet que deux jours après la signature, à Rethondes sur le front français, de l’armistice consacrant la défaite de l’Allemagne : le 13 novembre 1918, unilatéralement, les Soviétiques déclarèrent nulles et non avenues les cessions territoriales auxquelles ils avaient dû consentir par le traité de Brest-Litovsk ! Devant l’ampleur de leur défaite à l’ouest et devant la désagrégation de leur armée minée par des mouvements révolutionnaires, les Allemands n’eurent d’autre solution que de s’incliner.
59 Les Soviétiques ne modifièrent leur concept sur le caractère inévitable de la guerre qu’à la suite des deux étapes historiques que constituèrent pour eux les guerres contre la Pologne de 1919 à 1920, puis contre l’Allemagne nationale-socialiste de 1941 à 1945, ce qui les amena à adopter le concept de la coexistence pacifique.
60 La guerre étant inévitable, la tentation de l’exportation armée de la révolution devait se faire jour dès que la situation pouvait s’y prêter. L’éventualité avait été expressément prévue dès l’accession au pouvoir des Soviets, par Lénine notamment lorsqu’il signa, en tant que président du Conseil des commissaires du peuple, le 15 janvier 1918, le décret portant création de l’« Armée rouge des ouvriers et des paysans ». En effet, aux termes du décret, l’Armée rouge « sera le rempart du pouvoir des Soviets dans le présent, la base pour remplacer l’armée permanente par le peuple entier en armes dans un futur immédiat et elle servira de soutien à la prochaine révolution socialiste en Europe » 51 . Cette position de principe que la théorie avait conduit à établir ne pouvait être suivie d’aucune réalisation concrète en 1918. Bien plus, il avait même fallu signer le traité de Brest-Litovsk !
61 Cependant, l’analyse que les Soviétiques tirèrent de la situation générale, telle qu’elle se présentait en Europe, en mai 1920, leur indiquait qu’ils se trouvaient face à une possibilité historique qu’il fallait saisir. En effet, tout espoir de révolution mondiale prolétarienne venait de s’évanouir. Durant l’année 1919, avait été écrasée l’insurrection spartakiste en Allemagne, tout comme avaient été anéanties les républiques soviétiques de Hongrie et de Bavière. Par contre, l’Armée rouge avait battu les Blancs de Dénikine et ce qui restait des troupes contre-révolutionnaires russes s’était retranché en Crimée. La guerre contre les républiques baltes et la Finlande, avec des hauts et des bas, aboutissait à des séries de traités reconnaissant leur indépendance : l’effort essentiel de la puissance militaire soviétique pouvait être tourné contre l’ennemi principal, la Pologne ressuscitée par le traité de Versailles. Pour avoir voulu recouvrer à tout prix leurs frontières de 1772, celles d’avant les partages, les Polonais avaient accepté une lutte sur deux fronts : à l’ouest une guerre non déclarée contre les Allemands qui agissaient essentiellement avec leurs corps francs, à l’est contre les Soviétiques. Les Polonais refusant catégoriquement le tracé des frontières proposé par les Soviétiques, les négociations de paix avaient abouti à l’impasse. Après quelques succès initiaux importants, marqués par la prise de Minsk et de Kiev, ils avaient subi de lourdes défaites. L’Armée rouge attaquant sur deux axes, marchait sur Varsovie et sur Lvov. La chute de la Pologne signifiait l’irruption des soldats rouges en Allemagne et ainsi le nouvel embrasement d’un foyer révolutionnaire mal éteint.

62 La situation de la Pologne était désespérée. Au plan militaire, l’armée polonaise essayait de maintenir à l’ouest un front défensif contre les Allemands, front qu’elle dégarnissait autant qu’elle le pouvait pour s’efforcer d’enrayer le désastre à l’est, où les troupes en déroute refluaient en arrière de la Vistule. Au plan politique, la Pologne ne pouvait compter que sur le seul appui français au sein de l’Entente.
63 Politiquement isolés, à l’exception du soutien français, les Polonais l’étaient aussi en matière militaire. En effet, Allemands, Autrichiens et Tchécoslovaques s’opposaient radicalement à laisser transiter par leur territoire l’armement et la logistique que les Français envoyaient aux Polonais. Les Français avaient également expédié une forte mission militaire dont le général Weygand, l’ancien chef d’état-major du maréchal Foch, avait fini par prendre pratiquement la tête, mission qui comptait dans ses rangs le capitaine Charles de Gaulle, et dont l’ampleur s’apparentait plus à de l’encadrement qu’à une simple coopération technique. Les approvisionnements et les renforts français devaient donc emprunter la voie maritime et être débarqués à Dantzig. L’isolement polonais fut total lorsque l’offensive soviétique coupa la voie ferrée joignant Dantzig à Varsovie.
64 Les négociations des Soviets avec la Lettonie, dernière république balte avec laquelle ils étaient encore en guerre, s’acheminaient vers un traité dont la signature intervint le 11 août 1920. La paix avec la Lettonie, non seulement levait la dernière hypothèque d’une menace sur le flanc nord de l’Armée rouge, mais encore libérait un corps d’armée qui pouvait utilement participer aux opérations en second échelon. L’ensemble des forces rouges opérant contre la Pologne comptait quelque 400 000 hommes divisés en deux groupements. Celui du « Centre », le groupement principal, appelé aussi front « Ouest », avait pour objectif Varsovie et était sous le commandement de Thoukhatchevsky, ancien officier de l’Armée impériale, qui s’était déjà distingué contre les Blancs et les Baltes. Le deuxième groupement, avec pour objectif Lvov, était commandé par Egorov, également ancien officier de l’armée impériale, et avait comme adjoint politique Joseph Djougachvilli, un révolutionnaire de longue date, qui deviendra par la suite célèbre sous le pseudonyme de Staline. Ce groupement, le front « Sud-Ouest », comprenait, entre autres, la 1ère armée de cavalerie sous les ordres de Boudienny, qui commettra la faute majeure de mal assurer la liaison avec le groupement « Centre ».
65 L’état-major de Thoukhatchevsky, pas plus que celui de Trotsky, commissaire du peuple à la guerre, n’avait eu le temps d’élaborer le plan de l’ultime offensive que devait être l’opération de Varsovie. Aussi, le commandement de l’Armée rouge avait-il sorti des archives l’idée de manœuvre utilisée en septembre 1831 par le maréchal Paskïevitch pour la prise de la ville, ce qui avait mis fin à l’insurrection polonaise. Il s’agissait d’un concept originaire de l’école stratégique allemande, toujours inspiré par la manœuvre d’Hannibal à Cannes : l’enveloppement par les ailes avec le renforcement d’une aile battante jouant le rôle d’une faux pivotant sur le centre du dispositif. La victoire des Rouges ne semblait pas faire de doute, d’autant plus que le général Broussiloff, qui s’était illustré par la dernière offensive victorieuse menée par l’armée impériale russe, avait appelé tous les Russes à lutter contre l’ennemi de toujours, la Pologne. Le problème qui se posait aux Soviets était d’ordre politique et idéologique. Les dirigeants soviétiques avaient formellement reconnu l’indépendance de la Pologne le 28 août 1918 et la situation dans laquelle celle-ci se trouvait dans les derniers jours de juillet 1920 permettait aux Soviets de reprendre les négociations dans un cadre qui leur était favorable. L’autre solution était d’attaquer : la prise de Varsovie et la destruction de l’Etat polonais signifiait l’exportation armée de la Révolution. Trotsky était très en faveur de cette dernière solution, Lénine ne s’y opposa pas. « Le 23 juillet, les dispositions du commandement du front Ouest donnaient ordre d’encercler Varsovie au plus tard le 12 août » 52 . Thoukhatchevsky lança ainsi l’opération de Varsovie en proclamant à ses troupes que « le chemin de l’incendie mondial passe sur le cadavre de la Pologne ». Il porta le centre de son dispositif sur Varsovie et entama la bataille dans les faubourgs de la ville, Praga, située à l’est de la Vistule qui fut forcée au nord par l’aile droite. Les avant-gardes soviétiques, à l’ouest de la Vistule, entreprirent de se rabattre alors et engagèrent « le combat pour Radimine à 23 km de Varsovie » 53 , dont la population, éperdue, s’était précipitée dans les églises 54 . Certains de leur victoire, les Rouges n’essayèrent même pas de susciter le moindre mouvement parmi leurs partisans. Le corps diplomatique occidental, à de rares exceptions près en dehors des Français, avait abandonné Varsovie.
66 La direction politique et militaire de la Pologne était assurée par Joseph Pilsudski, un personnage qui allait entrer dans la légende. De petite noblesse, issu des confins polono-lithuaniens, catholique pratiquant mais méfiant à l’égard du Saint-Siège parce que le Pape, en 1831, avait condamné l’insurrection polonaise contre les Russes au nom de l’ordre établi de la Sainte-Alliance, Pilsudski avait adhéré au parti socialiste polonais après avoir, selon ses propres dires, commencé « à céder à l’influence des conceptions logiquement construites de Marx » 55 . Il fut impliqué avec Oulianov, le frère aîné de Lénine, dans un complot contre le Tsar Alexandre III, ce qui lui valut la déportation en Sibérie et à Oulianov une condamnation à mort. A son retour d’exil, Pilsudski bascula dans la clandestinité, fut arrêté et emprisonné à Saint-Petersbourg d’où il s’évada pour proposer, en 1904, aux Japonais de fomenter un soulèvement en Pologne contre les Russes, leurs adversaires communs. Après l’échec de la révolution de 1905 en Russie et en Pologne, Pilsudski avait estimé que la solution de l’indépendance polonaise passait par une alliance avec l’Autriche-Hongrie. A cette fin, fut constitué un corps de volontaires, les Légions, dont il prit le commandement et qui combattit contre les Russes en Galicie. Les Allemands durent cependant enfermer Pilsudski, lorsqu’il s’avéra que les promesses d’indépendance polonaise restaient sans suites réelles de la part de Berlin comme de Vienne. Libéré par la défaite allemande, il prit la tête du Conseil de régence à Varsovie avec l’appui de ses Légions.
67 Paderewsky, homme d’Etat et pianiste prestigieux, chef du Comité national polonais de Paris, arriva à convaincre Millerand et Clémenceau de l’intérêt que représentait Pilsudski révolutionnaire et socialiste bien qu’ex-allié des Allemands. Aux Légions de Pildsudski fut alors amalgamée la Légion polonaise formée en France, en 1917, qui avait combattu contre les Allemands : ce n’est pas le moindre des paradoxes qu’offraient la Pologne et Pilsudski. Autour de ce noyau dur avait été constituée une armée polonaise mal entraînée, mal armée et issue d’une levée en masse des paysans. Les Soviets étaient donc aux prises avec des forces polonaises réellement nationales et populaires, ainsi qu’avec un gouvernement dont l’un des chefs avait été compagnon de lutte du frère de Lénine ! Pilsudski eut des rapports compliqués avec la représentation française à Varsovie, notamment avec le général Weygand, qui lui reprochait une « vanité soupçonneuse et maladive » 56 , tout en lui reconnaissant « une énergie passionnée ».
68 Pilsudski avait étudié la stratégie et la tactique comme tous les révolutionnaires russes. Il était aussi passé par les écoles militaires autrichiennes et frappait les esprits « dans le domaine militaire par son intuition, son sens de la manœuvre et de l’action » 57 . Comme il s’était « amouraché de Napoléon » 58 , devant la manœuvre de Thoukhatchevsky, l’enveloppement par les ailes, il reprit le concept d’Austerlitz : la contre-attaque sur le centre. Le 15 août 1920, assumant personnellement le commandement direct des forces d’attaque 59 , Pilsudski lança ses Légions avec comme mot d’ordre : « A bas l’aigle à deux têtes peint en rouge » ! A une idéologie répondait une autre. La force de choc polonaise, les Légions, était appliquée au centre stratégique du dispositif des Rouges, à la jonction des groupements de Thoukhatchevsky et de Egorov, sur l’axe Brody-Byalistock. La contre-attaque polonaise enfonça les lignes soviétiques, se rabattit sur le flanc gauche de Thoukhatchevsky, anéantit son groupement, puis se retourna contre Boudienny. L’enthousiasme polonais était à son comble. Pour les Rouges, la retraite s’opéra dans l’abattement et la ruine des illusions 60 . Staline n’oublia jamais l’expérience malheureuse de la guerre de Pologne ni la vision des paysans polonais poursuivant des soldats soviétiques en fuite.
69 Les Soviets tirèrent les raisons de l’échec, tant au plan militaire que politique. Dans le domaine militaire, il y avait eu « supériorité de l’ennemi en forces, absence de coopération entre les fronts, utilisation malheureuse des forces du front Ouest, erreurs du commandement des fronts et du commandement suprême dans l’appréciation de l’ennemi, absence de réserves, faiblesse dans l’approvisionnement des troupes en armement et en logistique » 61 . Le catalogue de ces fautes militaires, dressé à la suite d’une défaite totale de l’Armée rouge, représente une première leçon que les stratèges soviétiques étudient inlassablement. Les erreurs politiques n’étaient pas moins graves aux yeux des Soviétiques et indissociables du domaine militaire. Au sujet de la guerre de Pologne, « dans sa déclaration, Lénine souligna que l’échec de l’offensive de l’Armée rouge devait être cherché aussi bien dans le domaine politique que de la stratégie militaire. Il provenait d’une surestimation de l’aptitude révolutionnaire des travailleurs polonais et aussi d’une surestimation des forces de l’Armée rouge sur la direction principale d’attaque. En même temps, l’activité de Trotsky à la tête du département militaire fut soumise à la critique » 62 .
70 La victoire polonaise, ce « miracle de la Vistule » de 1920, selon l’appellation que retint l’Histoire pour faire un pendant au « miracle de la Marne » de septembre 1914, eut des conséquences capitales, tant pour la Russie des Soviets que pour l’instauration d’une nouvelle situation en Europe.
71 La défaite soviétique était irrémédiable. La retraite de l’Armée rouge s’effectua dans les pires conditions. Par ailleurs, les Blancs de Wrangel, sans vouloir lier leurs mouvements aux Polonais qu’ils considéraient par nationalisme comme leurs ennemis aussi bien que les Rouges, avaient entamé des séries d’opérations en Russie méridionale avec à l’appui un projet politique consistant essentiellement en un système de distribution de la terre aux paysans. Le danger était donc d’importance, d’autant plus que les Polonais pouvaient devenir le fer de lance d’une croisade antisoviétique sous égide française et continuer leur contre-offensive. La République des Soviets se résolut à signer la paix de Riga qui rétablissait donc la Pologne dans ses frontières de 1772. Et l’Armée rouge déferla sur la Crimée, sous le mot d’ordre de « Tous contre Wrangel ! ».
72 La première conclusion à tirer de la défaite était qu’elle confortait entièrement les thèses développées par Lénine, en 1916, sur l’inégalité du développement du capital dans les pays à économie de marché et donc sur la possibilité d’instaurer le socialisme dans un seul pays sans attendre une révolution mondiale 63 . Les thèses de Trotsky, prônant le contraire, venaient donc de recevoir un démenti formel par les faits. En effet, la défaite des Soviets fermait la route à l’exportation armée de la Révolution, au moins momentanément, mais la paix de Riga ouvrait la possibilité de construire le socialisme dans un seul pays, en l’occurrence la Russie des Soviets. Le problème qui se posait dépassait le cas polonais.
73 En ce qui concerne la Pologne, la cause était entendue : le prolétariat polonais dirigé par Pilsudski non seulement ne s’était pas levé aux côtés de l’Armée rouge, mais s’était dressé contre elle. Quant à son chef, Pilsudski, il était indiscutablement un dirigeant du parti socialiste polonais, ancien rédacteur du « Robotnik », un journal socialiste polonais clandestin 64 , qui, à ce moment, ne pouvait être accusé d’être un mercenaire au service du capitalisme. Le problème réel était de déterminer si, au delà du cas polonais, il convenait de préparer la Russie des Soviets à une reprise de l’exportation armée de la révolution ou de concentrer les efforts en vue de la construction du socialisme dans un seul pays, tout en se tenant prêt à repousser une attaque des pays capitalistes, attaque jugée toujours inévitable. L’autre terme de l’alternative était de reprendre les thèses de Trotsky sur la nécessité de la révolution mondiale pour instaurer le communisme, faute de quoi le socialisme dans un seul pays ne pouvait que s’affadir et se dénaturer.
74 Après bien des débats, la question fut définitivement tranchée par l’abandon du concept d’exportation armée de la Révolution. Jamais les Soviets ne revinrent sur cette question. C’est donc à très juste titre qu’aux différents congrès du Parti, et notamment en 1986, il fut affirmé que les dirigeants soviétiques étaient « fermement convaincus qu’il est inutile et inadmissible de stimuler la révolution de l’extérieur et, à plus forte raison, par des moyens militaires » 65 . Cependant, la formulation employée par les Soviétiques dans le courant des années soixante-dix et quatre-vingt demande à être nuancée sur un point qui est loin d’être mineur ! En effet, les Soviétiques énoncent que « le socialisme n’a jamais, de son propre gré, lié son avenir aux règlements militaires des problèmes internationaux » et que « cela a été confirmé par la première grande discussion qui s’est développée dans notre parti après la victoire du Grand Octobre ». Or, à ce sujet, par « Grand Octobre », il est indispensable de comprendre la période englobant la guerre contre la Pologne, guerre qu’il est difficile d’assimiler à la guerre civile, puisque aucun Russe blanc ne se trouvait du côté polonais. Bien au contraire même, certains d’entre eux avaient rejoint l’Armée rouge à l’appel de Broussiloff. La grande discussion en question s’est bien déroulée après le Grand Octobre, mais après la défaite des Rouges sous Varsovie lorqu’il s’agissait de signer la paix de Riga, c’est-à-dire postérieurement à août 1920, soit quelque trois ans après la Révolution d’Octobre.
75 Lénine avait pris parti contre les thèses trotskystes, mais sa position ne s’affirma que devant le choc provoqué par l’événement que fut la défaite. Cependant, la position adoptée par Lénine, en 1918, n’allait pas jusqu’à s’opposer à l’offensive de l’Armée rouge dans un but qui, en août 1920, n’avait plus rien à voir avec la défense de la Révolution. Il s’agissait bien de son expansion armée à l’extérieur et certes non d’une stimulation d’un mouvement interne à la Pologne, mouvement d’ailleurs très faible, puisque toutes les énergies révolutionnaires avaient été accaparées par le parti socialiste polonais dont le dirigeant était Pilsudski. Aussi, lorsqu’un ministre de la défense soviétique affirme, en 1982, que « l’Union soviétique a toujours été et est toujours contre l’exportation de la Révolution » 66 , il commet une erreur manifeste : l’Union soviétique n’a pas toujours tenu cette position !
76 Cependant, si le concept de l’exportation armée de la révolution était désormais condamné, La guerre n’en était pas moins jugée inévitable avec les pays capitalistes, en fonction de l’agressivité inhérente de leur système socio-politique. Faute d’avoir pu l’emporter en Pologne, les Soviets s’estimaient contraints à préparer une guerre défensive qui ne pouvait donc manquer d’éclater. La solution résidait dans la préparation correcte de cette guerre inévitable, ce qui touchait essentiellement les domaines économiques et militaires. Il s’agissait de fournir aux armées rénovées une base économique ferme qui puisse leur procurer l’assise indispensable afin de remporter la victoire dans une lutte à mort prévisible. Ainsi, la question militaire – maintien intégral du concept du caractère inévitable de la guerre et abandon de celui de l’exportation armée de la révolution – renforçait la thèse de la construction du socialisme dans un seul pays qui sera définitivement adoptée sous l’impulsion de Staline, lors du plénum du Comité central du Parti, le 1 er août 1927.
77 Le premier acte de l’édification des bases économiques de l’Etat socialiste consistait à doter le pays d’une industrie lourde, ce qui rejoignait une préoccupation essentiellement militaire : donner au pays des moyens lui permettant de produire l’armement indispensable. La priorité à l’effort de défense dans le cadre du plan quinquennal fut réaffirmée au XV e congrès du Parti en décembre 1927 : « Prenant en compte la possibilité d’une attaque militaire des Etats capitalistes contre l’Etat socialiste, lors de l’élaboration du plan quinquennal, il est indispensable d’accorder l’attention maximale au développement le plus rapide des branches de l’économie nationale en général et de l’industrie en particulier auxquelles incombe le rôle primordial d’assurer la défense et la stabilité économique du pays en temps de guerre » 67 . Parallèlement, un intense travail d’organisation et de réflexion fut mené par toute une série de théoriciens alliant des compétences militaires et politiques. Frounzé et Thoukhatchevsky, notamment, s’illustrèrent dans ces études. Parmi les thèses défendues par Trotsky 68 , se trouvait celle d’une armée de milice, fondée sur le principe d’une levée en masse et de l’absence de forces permanentes. La condamnation des thèses générales de Trotsky et son élimination permirent à Frounzé de faire rejeter le principe de l’armée de milice, bien qu’il ait été prôné par Engels. L’Armée rouge reçut donc une structure d’armée permanente basée sur la conscription qui n’était d’ailleurs pas universelle : certaines couches sociales n’étaient pas admises au service armé. Parce que d’origine bourgeoise, elles étaient estimées peu sûres dans une lutte inéluctable mettant en jeu des concepts idéologiques et, en ce qui les concerne, le service armé était remplacé par des travaux d’utilité collective.
78 L’abandon du concept d’exportation armée de la révolution ne signifiait donc absolument pas l’adoption de celui de la coexistence pacifique tel qu’il est compris par les Soviétiques à partir des années cinquante. Le terme même est ignoré dans les décennies vingt, trente et quarante : il n’est question, et encore rarement, que de cohabitation pacifique 69 , étant entendu que l’affrontement armé est inévitable. La seule question qui se pose est de définir l’ennemi principal et le délai dont dispose la Russie des Soviets pour se préparer à la guerre.
79 Lénine, pourtant, est bien le premier artisan de la coexistence pacifique, parce que notamment dans ses thèses d’avril 1917, il estimait la cessation du conflit indispensable à l’instauration durable d’un pouvoir prolétarien en Russie. Cette même optique prévaudra, en 1920, après l’échec de Pologne. Cependant, en aucun cas, Lénine n’a établi le concept dans sa formulation des années cinquante : bien au contraire, il estimait la guerre inévitable entre pays se réclamant de systèmes socio-politiques différents.
La genèse de la coexistence pacifique : l’instauration du concept
80 Le passage du Niemen par les Allemands, à l’aube du 22 juin 1941, démontra aux Soviétiques la justesse de leur conception sur le caractère inévitable de la guerre. Pour eux, en effet, le national-socialisme allemand n’était qu’une expression du capitalisme. « Notre parti avait prévu le caractère inévitable de l’affrontement militaire avec les forces de l’impérialisme et avait préparé le pays et le peuple à la défense » 70 . Pourtant, le choc fut durement ressenti au point même que Staline dans un premier temps resta muet. Puis le 3 juillet 1941, en pleine débâcle de l’ Armée rouge, il lança aux « peuples et à tous les citoyens de l’Union soviétique » un appel aux armes annonçant qu’il s’agissait d’une lutte inexpiable du socialisme soviétique et de la Russie de toujours contre le national-socialisme et l’Allemagne. Staline faisait appel à l’idéologie communiste comme au patriotisme russe, invoquait Alexandre Nevsky, canonisé par l’église orthodoxe, Souvoroff et Lénine ! Il s’agissait de la Grande Guerre Patriotique qui ne pouvait se terminer autrement que par l’anéantissement de l’un des deux camps, ce qui n’était jamais que la réaffirmation d’un concept déjà déterminé depuis vingt ans.
81 L’attaque allemande aurait dû trouver les Soviétiques prêts et aptes à la repousser. Après la défaite française, la Grande-Bretagne fut seule à soutenir la guerre contre l’Allemagne durant une année, ce qui laissait aux Soviétiques le temps nécessaire à une analyse exhaustive des enseignements à tirer des campagnes de Pologne et de France. Or, après avoir écrasé les forces yougoslaves, puis grecques, en liaison avec les Italiens, l’armée allemande se tourna contre les Soviétiques et leur infligea une série de défaites retentissantes. La raison de ces défaites, d’après l’analyse soviétique, ne provient pas d’une quelconque supériorité des Allemands en matière d’armement ou de stratégie générale, qualifiée, pour sa part, d’aventureuse, mais d’une succession d’erreurs commises tant par le commandement suprême et la direction du pays que par l’Armée rouge. Il y a lieu de souligner ce point, parce qu’il est particulièrement représentatif de la réflexion stratégique soviétique : les causes d’une défaite sont recherchées en premier lieu par les Soviétiques dans leurs propres fautes. En d’autres termes, il y a là application du principe de l’autocritique.
82 Les Soviétiques ont ressenti d’autant plus durement leurs erreurs que les événements ont, à leurs yeux, démontré l’absolue justesse du concept marxiste-léniniste sur le caractère inévitable de la guerre. L’attaque allemande était donc prévisible et prévue. C’est dans le domaine de la stratégie et de la tactique que furent accumulées des fautes de raisonnement.
83 L’erreur essentielle relevée par les Soviétiques concerne la surprise dont ils furent victimes, surprise à deux niveaux : la date de l’offensive allemande et la rapidité avec laquelle fut menée cette offensive. « L’opinion du commandement suprême soviétique et de Staline en personne quant à la date de l’agression de Hitler contre l’Union soviétique constitue un exemple déplorable de grave erreur » 71 . Les Soviétiques estimaient invraisemblable une attaque en juin 1941. « On considérait comme possible le déclenchement de l’agression allemande à une date bien plus éloignée. On tâchait d’ailleurs d’ajourner cette échéance, en prenant à cet effet les mesures les plus diverses (pacte de non-agression avec l’Allemagne, désir d’éviter les provocations, tentative de conclusion d’une alliance militaire avec l’Angleterre et la France). Mais ces intentions ne purent être réalisées et l’agression s’accomplit » 72 . Les Soviétiques prévoyaient l’ouverture des hostilités pour 1943.
84 L’Armée rouge, en se préparant à une guerre qu’elle estimait inévitable avait basé sa stratégie sur l’offensive. « Le concept d’une guerre offensive active fut amplement souligné dans nos directives et instructions, de même que dans nos plans opérationnels et nos manœuvres » 73 . Le but de l’offensive était de mener à des séries de batailles d’anéantissement visant la destruction complète des forces ennemies, ainsi que l’avaient très expressément prévu les règlements de manœuvre élaborés en 1939 et en vigueur en 1941 : « Les opérations de l’Armée rouge auront pour but d’anéantir totalement l’ennemi » 74 . Les Soviétiques s’attendaient bien à une attaque surprise allemande, mais pensaient pouvoir procéder à la mobilisation et au déploiement de leurs troupes à l’abri des forces de couverture, ensuite passer à l’offensive et engager les opérations décisives sur le sol ennemi. « On était d’avis que dans les temps modernes l’attaque surprise serait de règle, sans déclaration de guerre officielle. Toutefois, aucune conclusion ne fut tirée sur le caractère et la nature de la période initiale intermédiaire entre le début des opérations militaires et l’engagement massif des forces armées ». La surprise stratégique fut ainsi totale, car « il n’était donc prévu que des opérations limitées en ce début de conflit. Cette vue erronée sur la période initiale a eu des effets négatifs sur la préparation de nos forces armées » 75 . Les armées allemandes qui avaient achevé leur concentration sur leurs axes d’effort lorsqu’elles passèrent à l’attaque, se saisirent de l’initiative, et livrèrent des séries de batailles offensives mobiles, selon le principe de la « guerre-éclair », contre des forces soviétiques contraintes d’adopter en catastrophe un dispositif défensif non planifié.
85 Les Soviétiques s’étaient également trompés sur les capacités allemandes de mobiliser l’ensemble des ressources nécessaires au maintien de l’effort de guerre. Il y avait eu mésestimation de ces capacités, notamment de la part du commandement suprême, de Staline donc, sur la base d’une analyse faite par l’Etat-major général des forces.
86 Autre lacune extrêmement grave qui se révéla avec les opérations, les états-majors manquaient de l’efficacité indispensable à la conduite des troupes dans une guerre de mouvement trop rapide pour eux. « Il fallut quelques mois amers pour acquérir l’expérience, dominer les événements, après quoi déjà le Grand quartier général du Commandement suprême et son appareil – l’Etat-major général – furent en mesure, le plus souvent, d’analyser en temps utile la situation, de proposer et prendre à temps les décisions » 76 .
87 Dernière erreur majeure, lourde de conséquences : à la suite de « conclusions erronées concernant l’emploi des chars, tirées sur la base de l’expérience limitée des opérations en Espagne » 77 , durant la guerre civile de 1936-1939, l’Armée rouge considérait les chars uniquement comme un appui direct de l’infanterie. Les corps blindés autonomes avaient donc été dissous. C’est en pleine guerre qu’il fallut les reformer et entreprendre la réalisation d’une coopération interarmes et interarmées qui faisait de même défaut.
88 Les Soviétiques, Staline le premier, n’ont jamais dissimulé les erreurs commises et n’ont pas attendu la destalinisation entreprise après le XX e congrès, en 1956, pour les mettre en lumière. C’est ainsi qu’en 1945, deux semaines après la capitulation allemande, lors d’une réception des principaux chefs militaires, au Kremlin, Staline a reconnu ses défaillances ouvertement : « Notre gouvernement a commis beaucoup d’erreurs. Nous nous sommes trouvés parfois dans des situations désespérées en 1941-1942 quand notre armée reculait, abandonnait nos villes et nos villages bien-aimés d’Ukraine, de Biélorussie, de Moldavie, de la région de Léningrad, des côtes de la Baltique, de la République carélo-finnoise et qu’elle les abandonnait parce qu’il n’y avait pas d’autres solutions » 78 . Cependant, les conclusions tirées des erreurs, ainsi que la confiance que les Soviétiques mettaient dans leur système gouvernemental et socio-politique, ont permis le redressement. « Un autre peuple aurait pu dire au gouvernement : vous ne vous êtes pas montrés dignes de notre attente, allez-vous en, nous installerons un autre gouvernement qui concluera la paix avec l’Allemagne et nous assurera la tranquillité. Mais, le peuple russe ne l’a pas fait, car il avait confiance dans la politique de son gouvernement et il s’est sacrifié pour assurer la défaite de l’Allemagne. Et cette confiance du peuple russe dans le gouvernement soviétique s’est révélée être la force décisive qui a permis la victoire historique sur l’ennemi de l’humanité, sur le fascisme ».
89 L’autocritique de Staline était, de plus, extrêmement habile puisque par la même occasion, elle permettait de rappeler qu’en dépit des erreurs, la volonté populaire n’avait pas rejeté le gouvernement soviétique et lui avait gardé sa confiance. En conséquence, Staline était lavé de ses fautes. Et effectivement, si les fautes reconnues de Staline sont à porter à son débit, la victoire dans sa totalité doit également lui être comptée. « Staline fut, durant la guerre, Président du Comité d’Etat de la Défense et Commandant suprême des Forces armées de l’URSS, et ses hautes qualités de chef militaire se manifestèrent à ces postes » 79 C’est bien lui qui conduisit à la victoire en assumant l’ensemble des responsabilités. « Un grand rôle en ce qui concerne l’obtention de la victoire sur l’ennemi a été joué par le haut niveau d’organisation et d’activité pratique du Grand quartier général avec à sa tête J.V. Staline et ses adjoints G.K. Joukov et A.M. Vassilievsky et aussi par l’organisme fondamental de direction du Grand quartier général qu’est l’Etat-major général » 80 . Pour sa part, Staline, outre la grandeur du peuple soviétique et en fin de compte la valeur du commandement militaire, attribuait la victoire au système socio-politique, ce qui lui conférait sa pleine légitimité : « Notre victoire signifie que notre système social a vaincu » 81 . Le résultat de la Seconde Guerre mondiale fut un renversement de la corrélation des forces, « la corrélation des forces dans l’arène internationale s’est modifiée d’une manière fondamentale en faveur du socialisme » 82 .
90 Au plan militaire les leçons des échecs initiaux de la guerre n’ont jamais été oubliées et les Soviétiques n’ont cessé de souligner le rôle essentiel de concepts fondamentaux tels que la surprise, la prise de l’initiative opérationnelle, la coopération des types et des catégories de forces, l’importance des arrières : « Juin 1941 ne se répètera pas » 83 !
91 Avec le changement du rapport des forces apparu au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, la question du caractère inévitable de la guerre devait irrémédiablement se poser en d’autres termes.
92 D’une part, l’URSS était victorieuse. En dehors de l’élimination totale de l’adversaire principal, le national-socialisme, la victoire avait amené la constitution d’un camp socialiste. L’URSS n’était plus le seul Etat prolétarien : l’accroissement de force du socialisme était indiscutable. D’autre part, le capitalisme, demeurait et était même renforcé avec la montée en puissance des Etats-Unis, devenus l’ennemi principal à la place de l’Allemagne. La parenthèse de l’alliance avec les démocraties occidentales ouverte par la guerre contre l’Allemagne se refermait avec la chute de cette dernière, au même titre que s’était ouverte et refermée la parenthèse constituée par le pacte de non-agression Ribbentrop-Molotov. Le problème d’avant-guerre de la construction du socialisme dans un seul pays se transposait désormais dans celui de la construction du socialisme dans le camp socialiste.
93 En aucun cas, il n’était question de revenir sur le concept de l’abandon de l’exportation armée de la révolution, c’est-à-dire d’engager la lutte par les armes avec les Occidentaux. Mais le nouveau rapport des forces, marqué par la puissance accrue du socialisme, faisait-il de la guerre la seule solution dans le conflit permanent qui l’opposait au capitalisme ?
94 La question fut introduite par Eugène Varga, un économiste d’origine hongroise, fondateur de l’« Institut de l’économie mondiale et des relations internationales » créé sous l’égide de l’Académie des Sciences de l’URSS 84 . Varga posa que les guerres entre Etats impérialistes n’étaient plus inévitables et qu’il en était de même entre Etats impérialistes et socialistes 85 . Les thèses de Varga battaient en brèche les positions que Lénine avaient fait admettre au début des années vingt et qui n’avaient jamais été mises en cause. Sur son premier point, l’absence de caractère inévitable de la guerre entre Etats impérialistes, Varga fut désapprouvé, notamment par Staline et fit une autocritique. Et en effet, bien des conflits entre Etats relevant de l’économie de marché se sont déroulés depuis 1946. Par contre, Staline admit d’abord avec nuance, puis plus franchement, le second point : la guerre entre le camp capitaliste et le camp socialiste n’était plus inévitable, tout en demeurant possible 86 . L’URSS et le camp socialiste avaient acquis une puissance générale telle qu’ils étaient aptes à décourager l’agression de la coalition impérialiste arrivée même à son plus haut degré de contradiction, donc au plus haut degré de bellicisme. Le chemin était, alors, ouvert à la possibilité d’une coexistence pacifique entre les deux systèmes sociaux opposés et c’est ce qui fut admis au XIX e congrès du PCUS en 1952. Staline lança un appel aux Américains à ce sujet peu de temps avant sa mort. « Je continue à croire, a-t-il dit, que la guerre entre les Etats-Unis d’Amérique et l’Union soviétique ne doit pas être estimée inévitable, que nos pays peuvent à l’avenir vivre en paix » 87 . Cependant, en dépit d’une confirmation répétée par tous les successeurs de Staline – la première en date est du 9 mars 1953, faite par Malenkov à l’occasion de son discours lors des funérailles de Staline – la coexistence pacifique ne sera réellement prise en compte par les Occidentaux qu’à la suite du XX e congrès du PCUS, en 1956, et de la publication du rapport secret de Khrouchtchev.
95 Sans se fonder sur une analyse du concept soviétique, Eisenhower a pressenti, en avril 1953, la possibilité d’une ouverture liée dans son esprit à la disparition de Staline. « Le 16 avril 1953, il dénonça la course aux armements, il demanda à la nouvelle direction soviétique d’ouvrir les yeux sur le risque de guerre et il fit une offre précise de désarmement universel » 88 . Eisenhower renchérit quelques mois plus tard en proposant devant l’ONU la création d’une Agence mondiale de l’énergie atomique et lança un programme « Atome pour la paix ».
96 Du côté soviétique, une tendance au sein du PCUS, opposée à la nouvelle ligne, subsista jusqu’en 1957 avec Molotov à sa tête, jusqu’à ce que celui-ci, en minorité, soit d’abord déchu de son poste de ministre des Affaires étrangères, en 1956, puis l’année suivante exclu du Comité central du Parti.
97 La nouvelle ligne stratégique, la coexistence pacifique, fut ainsi définitivement sacralisée en 1956, en déterminant une position qui allait au delà de la simple absence de guerre puisqu’il fut affirmé par les Soviétiques que « les pays ayant différents systèmes sociaux ne peuvent simplement exister côte à côte. Il faut aller plus loin, améliorer les rapports, raffermir la confiance entre eux, assurer la coopération » 89 . Parallèlement, le Secrétaire général du CC du PCUS annonçait l’exacerbation des luttes de libération nationale dans les nouvelles conditions historiques qui avaient permis l’instauration de la coexistence pacifique.
98 La nouvelle ligne stratégique avait été donc établie sur la base de la perception d’un nouveau rapport de force. La modification de la perception soviétique tire son origine essentiellement de quatre points. Lors de la crise de Berlin, en 1947 et en 1948, l’URSS a estimé avoir démontré une parité des forces avec les Occidentaux, sa suprématie en forces conventionnelles compensant l’infériorité due à la possession unilatérale de l’arme nucléaire par les Etats-Unis : si les Américains se sont refusés à forcer les barrages terrestres soviétiques interdisant l’accès à Berlin, les Soviétiques n’ont pas plus tenté d’utiliser la force pour interrompre le pont aérien. La guerre de Corée a démontré la même parité de forces entre les deux camps, outre le fait que les Occidentaux ont reculé devant l’emploi de l’arme nucléaire. La technologie soviétique a permis l’obtention de l’arme nucléaire en 1949 et thermonucléaire en 1953, ce qui a établi une parité de principe en ce domaine. Dernier point capital, la conclusion du pacte de Varsovie, en 1955, a institutionnalisé l’organisation des deux systèmes socio-politiques opposés en deux coalitions militaires.
99 Inattendue à l’origine, la coexistence pacifique allait cependant alimenter l’affrontement entre la Chine et l’URSS, tandis que les Occidentaux la percevaient, bientôt, comme une machine de guerre permettant aux Soviétiques de prononcer une offensive en direction du Tiers monde.
100 Toute l’ambigüité contenue dans le concept de coexistence pacifique se retrouve dans le rapport de Khrouchtchev au XX e congrès ainsi que dans le rapport secret sur la destalinisation.
101 Khrouchtchev adopte une nouvelle ligne stratégique dans la continuité qui s’est ouverte à Bandoeng en 1955, où l’URSS n’était pas partie prenante. L’absence de l’URSS à ce premier sommet tiers-mondiste tenu sous l’influence prépondérante de la Chine indiquait aux Soviétiques une nouvelle orientation dans les relations internationales, orientation qui les dépassait. Jusque là, suivant Lénine et Staline, l’URSS s’était axée sur l’Europe et son duel avec le capitalisme occidental. Le rapport des forces gelait la situation dans cette partie de la planète. Mais, ailleurs, l’émergence de la Chine à Bandoeng signifiait sans ambages une poussée du Tiers monde orchestrée par les Chinois et non par les Soviétiques qui perdaient ainsi leur rôle dirigeant, au moins partiellement, dans la coalition anti-occidentale. Il devenait urgent pour les Soviétiques de s’adapter aux nouvelles conditions. C’est ainsi que le XX e congrès réaffirma avec force le concept de coexistence pacifique, ce qui contribuait à geler encore plus la situation sur le front européen anti-occidental et permettait un transfert de forces en direction du Tiers monde. Au XX e congrès, donc, Khrouchtchev, en tant que Secrétaire général du PCUS, insista sur la coexistence pacifique et parallèlement énonça un soutien accru aux mouvements de libération nationale. Cette nouvelle ligne stratégique se concrétisa par un appui à l’Egypte de Nasser comme à la révolution cubaine de Fidel Castro.
102 En Europe, la coexistence pacifique matérialise une situation figée. Les blocs Est et Ouest campent sur leurs positions respectives. L’accession de l’URSS, en octobre 1957, à la maîtrise des missiles à portée intercontinentale souligne cette situation figée. Le domaine prioritaire de 1917 à 1956, qu’est l’adversaire occidental, le reste, mais il cesse d’être le seul. La vision de Staline, uniquement centré sur l’Europe est abandonnée. Plus exactement, les Soviétiques adjoignent le Tiers monde comme deuxième axe d’effort au premier, la lutte contre l’OTAN, qui reste prioritaire.
103 Au plan militaire, d’une manière générale, face aux Occidentaux, les Soviétiques ne procèdent à aucun redéploiement de leurs forces. Ils les adaptent par contre aux nouvelles conditions que leur procure l’accroissement de leur puissance nucléaire. C’est ainsi que sont créées les Troupes des fusées stratégiques nucléaires, en tant que catégorie d’armée indépendante. C’est ainsi qu’est également créée de la même manière une autre catégorie d’armée, la PV0 90 , la « Défense antiaérienne nationale », et que le corps de bataille est doté d’un armement nucléaire dont les portées correspondent à toutes les conditions prévisibles d’une bataille. Par contre, en ce qui concerne leurs forces navales, fait nouveau, les Soviétiques se lancent dans une expansion permanente. Un effort considérable est consenti en faveur de la flotte. Il s’agit d’une part d’améliorer les performances des moyens dirigés directement contre les Occidentaux : sous-marins à propulsion nucléaire lanceurs de missiles intercontinentaux, sous-marins d’attaque chargés de lutter aussi bien contre les sous-marins nucléaires adverses que contre les bâtiments de surface. Mais, d’autre part, la marine de surface bénéficie d’un fort développement. Il s’agit à la fois de disputer la maîtrise des mers aux Occidentaux, notamment aux Américains, et d’une projection de forces apte à participer au soutien des mouvements de libération nationale.
104 Le soutien aux mouvements de libération nationale conduit également les Soviétiques à impliquer dans l’action leurs alliés européens. Cependant, les Soviétiques prendront toujours grand soin à ce que leurs forces ou celles de leurs alliés du pacte de Varsovie ne soient jamais engagées directement contre des formations occidentales : le respect du concept de coexistence pacifique comporte l’absence d’affrontement armé avec les pays de l’OTAN.
105 Au plan économique, les alliés du Pacte seront également mis fortement à contribution afin de participer au soutien des mouvements de libération nationale. Le CAEM offrira le cadre nécessaire.
106 Le concept de coexistence pacifique, avec son prolongement tiers-mondiste, sera appliqué sans aucune modification jusque dans le courant des années quatre-vingt et l’ère brejnévienne s’est inscrite dans la suite de celle de Khrouchtchev. Les Occidentaux, dans leur perception de la coexistence pacifique, n’enregistreront que des pertes de position, sans pour autant prendre en compte que le fardeau soviétique du soutien aux luttes de libération nationale s’alourdissait, non seulement au plan économique, mais encore politique et militaire. En effet, sur ces deux derniers plans, l’adoption du concept de coexistence pacifique provoqua la rupture de l’alliance sino-soviétique 91 et même l’affrontement. En dehors des oppositions idéologiques, la question en jeu était un duel entre Chinois et Soviétiques pour prendre le rôle dirigeant dans la lutte du Tiers monde contre les Occidentaux.
107 Bien que constamment réaffirmée, la coexistence pacifique subira une série d’altérations allant pratiquement jusqu’à une accentuation de la guerre froide avec la mise en place des missiles soviétiques SS-20 à portée intermédiaire et celle correspondante en Europe des missiles américains Pershing II et de croisière, ainsi que les interventions des Soviétiques en Afghanistan, des Américains à Grenade, l’annonce de l’Initiative de défense stratégique américaine.
108 La relance de la coexistence pacifique intervint dans la seconde moitié de la décennie quatre-vingt et est due à l’initiative des Soviétiques. Le programme de désarmement proposé par M. Gorbatchev a abouti au traité de Washington de 1987 qui représente une donnée totalement nouvelle dans l’histoire des relations Est-Ouest. En effet, pour la première fois, a été conclu un accord qui dépasse une limitation des armements puisqu’il s’agit d’une réduction. Le concept de coexistence pacifique a pris un nouveau cours avec les infléchissements que lui a donnés la direction de M. Gorbatchev. Dans une première approche, la priorité à l’axe européen et anti-occidental, donnée immuable de la stratégie soviétique, a été intégralement maintenue. Par contre, le deuxième axe d’effort, le soutien aux mouvements de libération nationale des ères khrouchtchevienne et brejnévienne est passé en troisième priorité au profit du Pacifique érigé en deuxième priorité. La coexistence pacifique, dans sa nouvelle forme, s’inscrit dans la perestroïka, cette révolution dans la Révolution, dont M. Gorbatchev attend qu’elle accélère le processus de réforme de la société soviétique dans le sens de l’efficacité sans s’écarter le moins du monde des voies socialistes. Dans une deuxième approche, le concept de coexistence pacifique va interférer avec celui de la « Nouvelle pensée politique » et afin de ne pas être en contradiction avec lui, il lui faudra subir des adaptations. L’axe tiers-mondiste disparaîtra totalement : l’URSS et la Russie s’en dégageront totalement, les affaires internes ayant toute priorité.
109 La coexistence pacifique a eu des répercussions dans la vie sociale des pays de l’Est, certes moins bien perçues en Occident que le domaine international. Lorsqu’il en a initié le processus, Staline n’avait certainement pas mesuré toutes les conséquences au plan interne. En posant que la guerre avec les Occidentaux n’était plus inéluctable, mais possible, il était tout à fait logique d’adopter en conséquence le concept de coexistence pacifique. Par contre, il était hors de la norme de pouvoir maintenir un état de tension interne dont la justification était la situation de forteresse assiégée du camp socialiste, forteresse assiégée condamnée à vaincre dans une guerre d’anéantissement imminente déclenchée par les Occidentaux. Avec la disparition de cette justification de la tension, la même logique commandait de suspendre l’état d’exception dans lequel se trouvait l’URSS depuis 1917 et le camp socialiste depuis 1946 : la déstalinisation mise en œuvre par le XX e congrès de 1956 devait inévitablement être approfondie. En corollaire, le conflit permanent avec le capitalisme subsistant, mais prenant une autre forme, l’importance de l’économie ne pouvait que croître et il en a résulté une mise en question de l’efficacité de l’économie soviétique. En ce qui concerne l’économie, un constat de carence fut dressé dès 1956 et, sous l’influence de l’économiste Libermann 92 , il fut proposé un assouplissement de la planification centralisée et une restauration de la norme du profit dans les entreprises, sans pour autant mettre en question, aussi faiblement que ce soit, la propriété collective des moyens de production. La réforme préconisée fut appliquée à titre expérimental dans une entreprise de confection, puis généralisée dans l’industrie légère, au cours des années soixante, et finalement pratiquement abandonnée. La perestroïka de Gorbatchev relança le problème, mais à une échelle autrement plus grande, puisqu’il s’agissait là de s’attaquer à la source estimée des défauts, à savoir les comportements mêmes des agents économiques dans leur ensemble. D’une réforme économique partielle proposée par Libermann, Gorbatchev passait à un problème de société, mais en voulant conserver, à l’origine, une donnée intangible : le maintien intégral du système socialiste.
110 La référence à Lénine, en ce qui concerne la naissance du concept de coexistence pacifique, perpétuellement rappelée par les différents dirigeants soviétiques, y compris par Gorbatchev, souligne l’ambiguïté du concept. En effet, il est très difficile, historiquement, d’attribuer ce concept à Lénine qui ne lui a consacré ni débat ni œuvre magistrale. Par contre, c’est bien Lénine qui a signé, le 15 janvier 1918, le décret portant création de l’Armée rouge des ouvriers et des paysans qui devait servir « de soutien à la prochaine révolution en Europe ». C’est bien d’exportation armée de la Révolution qu’il s’agissait et Lénine n’avait jamais perdu sa vision mondialiste d’une extension de la Révolution, par les armes éventuellement.
111 La question militaire est au centre du problème de la coexistence pacifique. C’est l’évolution de la perception raisonnée de l’éventualité d’une guerre générale qui a permis l’émergence du concept de coexistence pacifique. Le point capital, le tournant, dans l’adoption du concept, n’est en aucun cas le XX e congrès de 1956 : ce serait plus l’acceptation par Staline au XIX e congrès d’une partie des thèses de Varga.
112 La coexistence pacifique conserve son caractère conflictuel, y compris avec M. Gorbatchev jusqu’à l’abolition progressive du concept directeur de la lutte des classes. L’explication réside dans les ambiguïtés originelles du concept de coexistence pacifique, parce qu’il découle d’une analyse du rapport des forces militaires. Les dirigeants soviétiques en ont bien conscience et n’en font pas mystère. C’est ce que déclare M. Gorbatchev en s’adressant à des hommes d’affaires américains lors de la signature du traité de Washington de 1987, portant sur le démantèlement des missiles à portée intermédiaire : « Il est probable que vous voudriez bien vous débarrasser de l’Union soviétique afin qu’elle ne vous gène plus. Il est tout aussi probable que certains d’entre nous voudraient se débarrasser de l’Amérique, pour qu’elle ne gène plus » 93 . Cependant, « cette tournure d’esprit est irréaliste » du fait du caractère suicidaire d’une guerre nucléaire intercontinentale et de l’inanité de la course aux armements. Il en découle qu’il faut bien prendre en compte que « l’Amérique et l’Union soviétique sont de grandes réalités de notre époque. Par conséquent, il nous faut vivre ensemble et coexister ».
113 Le développement de la perestroïka et de la Nouvelle pensée politique va mettre à mal le socle idéologique sur lequel est bâtie l’Union soviétique. Le concept de coexistence pacifique n’y échappera pas.
114 La coexistence pacifique était une justification plus politique qu’idéologique à l’abandon de la démonstration léniniste sur le caractère inéluctable de l’affrontement entre les systèmes marxiste-léniniste et capitaliste. En faisant transcender cet affrontement par une valeur supérieure, un humanisme socialiste que leur dictait une nouvelle pensée politique, les réformateurs soviétiques, dans les dernières années de la décennie quatre-vingt, vidaient la coexistence pacifique de toute substance. Elle n’avait pas plus de raison d’exister que le marxisme-léninisme.
115 Les réformateurs soviétiques souhaitaient passer à un nouvel état des relations internationales caractérisé par un partenariat avec leurs ennemis déclarés. Il en résulte, de leur part, une dégradation du concept de la lutte des classes, qui était la raison première de la confrontation. Mais, ce faisant, poussant la coexistence pacifique dans une ultime étape, les réformateurs érodaient le noyau idéologique du marxisme de même qu’ils ôtaient toute signification idéologique au duel qu’avait soutenu l’Union soviétique contre les Occidentaux. Pire, le duel n’avait plus de justification, apparaissait comme une erreur et les sacrifices encourus devenaient, par voie de conséquence, inutiles. Dans son ultime étape, la coexistence pacifique, conduisant au partenariat, condamnait le marxisme.
Notes de bas de page
1 Cf. Marx et Engels. Œuvres complètes. Moscou, 1970. T. 38, p. 337.
2 Volkogonov. La guerre et l’armée. Moscou, 1977. p. 80.
3 Ogarkov. L’histoire enseigne la vigilance. Moscou, 1985. p. 13.
4 Cf. Lénine. Œuvres complètes. Moscou, 1970. T. 49, p. 118, 369 et 370 ; T. 32, p. 80.
5 Gretchko. Les forces armées de l’Etat soviétique. Moscou, 1975. p. 348.
6 Cf. L’étoile rouge du 15 mars 1980.
7 Encyclopédie militaire soviétique. Moscou, 1977. T. 3, p. 225.
8 Cf. Dictionnaire encyclopédique militaire. Moscou, 1984. p. 240. Cf. Ogarkov. L’histoire enseigne la vigilance. Moscou, 1985. p. 57. Cf. Gretchko. Les forces armées de l’Etat soviétique. Moscou, 1975. p. 340.
9 Gretchko. Les forces armées de l’Etat soviétique. Moscou, 1975. p. 346.
10 Gretchko. Les forces armées de l’Etat soviétique. Moscou, 1975. p. 345
11 Ibidem, p. 344
12 Ogarkov. L’histoire enseigne la vigilance. Moscou, 1985. p. 58.
13 Ibidem, p. 59
14 Encyclopédie militaire soviétique. Moscou, 1976. T. 2, p. 183. Dictionnaire encyclopédique militaire. Moscou, 1984. p. 136.
15 Cf. Gretchko. Les forces armées de l’Etat soviétique. Moscou, 1975. p. 313. Cf. Ogarkov. L’histoire enseigne la vigilance. Moscou, 1985. p. 58.
16 Sokolovsky. Stratégie militaire. Moscou, 1968. Traduction française, Paris, 1984. p. 25.
17 Gretchko. Les forces armées de l’Etat soviétique. Moscou, 1975. p. 349.
18 Ogarkov. L’histoire enseigne la vigilance. Moscou, 1985. p. 58.
19 Dictionnaire encyclopédique militaire. Moscou, 1984. p. 514.
20 Cf. Guibert. E ssai général de tactique. Paris, 1803. Réédition partielle, édition Copernic. Paris, 1977.
21 Gretchko. Les forces armées de l’Etat soviétique. Moscou, 1975. p. 354. Rezničenko. La tactique. Moscou, 1984. p. 7.
22 Cf. Beaufre. Introduction à la stratégie. Paris, 1964.
23 In Pravda du 12 juin 1981.
24 Lénine. Œuvres complètes. Moscou. T. 45, p. 409.
25 Marx et Engels. Œuvres complètes. Moscou, 1977. T. 7, p. 509.
26 Ibidem, p. 510.
27 Appel du Congrès des députés du peuple de l’URSS aux peuples du monde. Moscou, 9 juin 1989. Agences TASS-APN.
28 Conférence de presse de M. Gorbatchev, chef de l’Etat soviétique et Secrétaire général du CC du PCUS, à l’issue de sa visite en RFA, 13 juin 1989. Agences TASS-APN.
29 Cf. Déclaration conjointe URSS-USA, 15 juin 1989. Agences TASS-APN.
30 Encyclopédie militaire soviétique. Moscou, 1978. T. 5, p. 319.
31 Rapport de L.I. Brejnev, Secrétaire général du CC du PCUS, au XXIV e congrès du PCUS, le 30 mars 1971.
32 Boutenko. Le système socialiste mondial et l’anticommunisme. Moscou, 1972. p. 218.
33 Gretchko. Les forces armées de l’Etat soviétique. Moscou, 1975. p. 385.
34 Rapport présenté par L.I. Brejnev, Secrétaire général du CC du PCUS, au XXV e congrès du PCUS, le 24 février 1976.
35 Programme du PCUS. Moscou, 1976. p. 59.
36 Gorbatchev. Perestroïka. Paris, 1987. p. 200.
37 Ibidem, p. 201.
38 Ibidem, p. 208.
39 Ibidem, p. 210.
40 Sokolovsky. Stratégie militaire. Paris, 1984. p. 82.
41 In Pravda du 25 octobre 1979, Oustinov, La détente militaire, un impératif du temps.
42 Encyclopédie militaire soviétique. Moscou, 1978. T. 5, p. 319.
43 Volkogonov. La guerre et l’armée. Moscou, 1977. p. 49.
44 Rapport politique du CC du PCUS présenté par M. Gorbatchev, Secrétaire général du CC du PCUS, au XXVII e congrès du PCUS, le 25 février 1986.
45 Gorbatchev. Perestroïka. Paris, 1987. p. 37.
46 Gorbatchev. Perestroïka. Paris, 1987. p. 37.
47 Cf. Le Monde du 13 décembre 1987, Henri de Bresson, Restucturer les normalisés…
48 Gorbatchev. Perestroïka. Paris, 1987. p. 130.
49 Rapport présenté par Lénine au VIII e congrès du parti communiste bolchévique de Russie, en mars 1919.
50 Gorbatchev. Perestroïka. Paris, 1987. p. 69.
51 Le PCUS et les Forces armées de l’Union soviétique-Documents. 1917-1981. Moscou, 1981. p. 25.
52 Encyclopédie militaire soviétique. Moscou, 1977. T. 3, p. 18.
53 Encyclopédie militaire soviétique. Moscou, 1976. T. 2, p. 18.
54 Cf. Malaparte. Technique du coup d’Etat. Paris, 1931.
55 Pilsudski. Du révolutionnaire au chef d’Etat. 1893-1935. Œuvres, discours et ordres. Paris, 1935. p. 22.
56 Weygand. Mémoires. Mirages et réalité. Paris, 1957. T. 2, p. 152.
57 Ibidem, p. 106.
58 Pilsudski. Du révolutionnaire au chef d’Etat. 1893-1935. Œuvres, discours et ordres. Paris, 1935. p. 17.
59 Cf. Weygand. Mémoires. Mirages et réalité. Paris, 1957. T. 2, p. 145.
60 Cf. Babel. Œuvres choisies – L’armée de cavalerie. Moscou, 1966. Traduction en français sous le titre de Cavalerie rouge. Paris, 1930.
61 Encyclopédie militaire soviétique. Moscou, 1976. T. 2, p. 19.
62 Encyclopédie militaire soviétique. Moscou, 1977. T. 3, p. 18.
63 Cf. Lénine. Le programme militaire de la révolution prolétarienne. Œuvres complètes. T. 19. Moscou, 1929.
64 Cf. Pilsudski. Biboula. Paris, 1932.
65 Rapport présenté par M. Gorbatchev, Secrétaire général du PCUS, au XXVII e congrès du PCUS, le 25 février 1986.
66 Oustinov. Nous servons la patrie, la cause du communisme. Moscou, 1982. p. 18.
67 Résolutions du XV e congrès du Parti. Cité notamment par Gretchko, Les forces armées de l’Etat soviétique. Moscou, 1975. p. 178.
68 Cf. Trotsky. L’art de la guerre et le marxisme. Paris, 1975.
69 « Mirnojé sožitelstvo ».
70 Cf. Pravda du 3 juillet 1941.
71 Chtemenko. L’Etat-major général soviétique en guerre. Moscou, 1976, p. 556-557.
72 Chtemenko. L’Etat-major général soviétique en guerre. Moscou, 1976, p. 556 557
73 Sokolovsky. Stratégie militaire. Paris, 1984. p. 200.
74 Ibidem, p. 201.
75 Ibidem, p. 201 et 202.
76 Chtemenko. L’Etat-major général soviétique en guerre. Moscou, 1985. p. 345.
77 Ogarkov. L’histoire enseigne la vigilance. Moscou, 1985. p. 43.
78 In Pravda du 25 mai 1945, allocution de Staline lors de la réception au Kremlin, le 24 mai 1945, des principaux chefs militaires des Forces armées soviétiques.
79 Chtemenko. L’Etat-major général soviétique en guerre. Moscou, 1976. p. 540.
80 In L’étoile rouge du 9 mai 1984, Ogarkov, La défense du socialisme : l’expérience de l’histoire et l’époque contemporaine.
81 Staline. Œuvres. Volume 3. Stanford, USA, 1967. p. 7.
82 Ogarkov. Toujours prêt à la défense de la patrie. Moscou, 1982. p. 11.
83 In L’étoile rouge du 9 mai 1984, Ogarkov, La défense du socialisme : l’expérience de l’histoire et l’époque.
84 Voir à ce sujet, Romer, La notion de crise générale du capitalisme dans l’idéologie soviétique. Thèse de doctorat de 3 e cycle. Université de Paris, Sorbonne, 1976.
85 Cf. Varga. Les changements dans l’économie du capitalisme au bilan de la Seconde Guerre mondiale. Moscou, 1946.
86 Cf. Staline. Les problèmes économiques du socialisme. Moscou, 1952. Stanford University Press. Stanford. USA.
87 In Pravda du 26 décembre 1952 et in Stalin Works , T. 3 (XVI), Hoover Institution on war and peace, Stanford, USA, 1967. Staline, réponses aux questions posées par le correspondant diplomatique du New York Times , James Reston, le 21 décembre 1952.
88 Hoffmann. Detent in The making of America’s soviet policy. Yale University Press, USA, 1984. p. 232.
89 Rapport présenté par Khrouchtchev, Secrétaire général du CC du PCUS, au XX e congrès du PCUS, le 14 février 1956.
90 « Protivo-Vozdušnaja Oborona strany ».
91 Voir The sino-soviet conflict. A global perspective. University of Washington Press, USA, 1982.
92 Cf. Libermann. Moyens d’élever la responsabilité des entreprises socialistes. Moscou, 1956.
93 Discours de M. Gorbatchev, lors de sa rencontre avec des hommes d’affaires américains à l’ambassade de l’URSS, à Washington, le 10 décembre 1987. Agences Tass et Novosti.
Le texte seul est utilisable sous licence Licence OpenEdition Books . Les autres éléments (illustrations, fichiers annexes importés) sont « Tous droits réservés », sauf mention contraire.

Les Europe des Européens
René Girault et Gérard Bossuat (dir.)

Le marché du charbon, un enjeu entre l’Europe et les États-Unis de 1945 à 1958
Régine Perron

L’Europe des Français, 1943-1959
La IV e République aux sources de l’Europe communautaire
Gérard Bossuat

Les identités européennes au XX e siècle
Diversités, convergences et solidarités
Robert Frank (dir.)

La soif de Jérusalem
Essai d’hydrohistoire (1840-1948)
Vincent Lemire

Misère de l’historiographie du « Maghreb » post-colonial (1962-2012)
Pierre Vermeren

Autour des morts de guerre
Maghreb - Moyen-Orient
Raphaëlle Branche, Nadine Picaudou et Pierre Vermeren (dir.)

Capitales culturelles, capitales symboliques
Paris et les expériences européennes (XVIII e -XX e siècles)
Christophe Charle et Daniel Roche (dir.)

Le Paris des étrangers depuis 1945
Antoine Marès et Pierre Milza (dir.)

Au service de l’Europe
Crises et transformations sociopolitiques de la fonction publique européenne
Didier Georgakakis

Le laboratoire démocratique : le Mexique en révolution 1908-1913
Elisa Cárdenas Ayala

Diplomatie et religion
Au cœur de l’action culturelle de la France au XX e siècle
Gilles Ferragu et Florian Michel (dir.)

Accès ouvert freemium
PDF du chapitre
Édition imprimée
Merci, nous transmettrons rapidement votre demande à votre bibliothèque.
Vérifiez si votre bibliothèque a déjà acquis ce livre : authentifiez-vous à OpenEdition Freemium for Books . Vous pouvez suggérer à votre bibliothèque d’acquérir un ou plusieurs livres publiés sur OpenEdition Books. N’hésitez pas à lui indiquer nos coordonnées : access[at]openedition.org Vous pouvez également nous indiquer, à l’aide du formulaire suivant, les coordonnées de votre bibliothèque afin que nous la contactions pour lui suggérer l’achat de ce livre. Les champs suivis de (*) sont obligatoires.
Veuillez, s’il vous plaît, remplir tous les champs.
La syntaxe de l’email est incorrecte.
Le captcha ne correspond pas au texte.
Ce livre est diffusé en accès ouvert freemium. L’accès à la lecture en ligne est disponible. L’accès aux versions PDF et ePub est réservé aux bibliothèques l’ayant acquis. Vous pouvez vous connecter à votre bibliothèque à l’adresse suivante : https://freemium.openedition.org/oebooks
Si vous avez des questions, vous pouvez nous écrire à access[at]openedition.org
Référence numérique du chapitre
Référence numérique du livre

- LANGUE FRANÇAISE
- DICTIONNAIRES BILINGUES
- TRADUCTEUR
- CONJUGATEUR
- ENCYCLOPÉDIE
- CUISINE
- FORUM
- JEUX
- LIVRES
- Suivez nous:
- EN ES DE IT
coexistence pacifique

Principe selon lequel deux États ou groupes d'États, aux idéologies opposées, acceptent de ne pas entrer en conflit armé.
1. Portée de la coexistence pacifique
Au delà de son sens général, le terme de coexistence pacifique s’applique avant tout à la doctrine politique soviétique prônant l'abandon de la course aux armements et des perspectives de confrontation militaire avec les pays capitalistes tout en maintenant le combat contre ceux-ci sur les plans idéologique, scientifique, culturel et économique.
1.1. Priorité à la négociation

La formule fut lancée par Khrouchtchev au XX e Congrès du parti communiste de l'URSS (PCUS) en février 1956. Selon le dirigeant soviétique, il fallait que les pays ayant des systèmes sociaux différents apprennent à vivre ensemble sur la planète, à « coexister » pacifiquement : « La reconnaissance de deux systèmes différents, la reconnaissance à chaque peuple du droit de régler lui-même tous les problèmes politiques et sociaux de son pays, le respect de la souveraineté et l'application du principe de la non-ingérence dans les affaires intérieures, le règlement de tous les problèmes internationaux au moyen de pourparlers, voilà ce qu'implique la coexistence pacifique sur une base raisonnable ».
1.2. Maintien de la lutte
Mais, dans l'esprit de Khrouchtchev, cette nouvelle ligne de la politique étrangère ne signifiait ni que l' URSS renonçait à son idéologie, ni qu'elle abandonnait sa lutte contre le capitalisme. La fin restait la même, mais pas les moyens employés pour y parvenir : « Quant aux questions idéologiques, nous nous en sommes tenus et nous nous en tiendrons, inébranlables tel un roc, aux principes du marxisme-léninisme. […] Nous, citoyens d'États socialistes, nous n'approuvons pas le régime capitaliste et l'idéologie bourgeoise. Mais, il nous faut vivre en paix et régler les problèmes internationaux qui se présentent par des moyens pacifiques seulement ».
La coexistence pacifique ouvrit la voie à une nouvelle ère dans les relations internationales. À la guerre froide succéda la détente (1962-1975), période durant laquelle les rapports américano-soviétiques connurent une certaine embellie.
2. Les causes de la coexistence pacifique
2.1. de nouvelles conditions internationales.
L'adoption par l'URSS de la doctrine de la coexistence pacifique s'explique par divers facteurs : changement du personnel politique en URSS (mort de Staline en 1953, remplacé par Khrouchtchev), émergence du tiers-monde et du mouvement des non-alignés ( conférence de Bandung en 1955), fin des conflits armés en Corée (1953) et en Indochine (1954), départ des Soviétiques d'Autriche (1955).
2.2. L'impasse stratégique et militaire

Mais ce sont surtout les causes stratégiques et militaires qui sont à l'origine de ce revirement : après la Seconde Guerre mondiale, les Américains étaient les seuls à posséder l'arme atomique, ce qui leur conférait une supériorité militaire sans précédent. Les Soviétiques mirent fin à ce monopole en se dotant de la bombe A (1949), de la bombe H (1953), puis en lançant Spoutnik (1957), ce qui eut un retentissement considérable aux États-Unis.
Étant parvenus à un niveau technologique équivalent, les deux Grands se devaient, pour éviter un affrontement nucléaire général, de cohabiter et de reconnaître leurs sphères d'influence respectives.
2.3. La coexistence pacifique à l'épreuve des faits (1956-1962)

Mais les effets de cette nouvelle politique ne furent pas immédiats. Si, après 1956, les contacts entre l'Est et l'Ouest se multiplièrent (voyage de Khrouchtchev aux États-Unis en 1959, rencontre de celui-ci à Vienne avec le président américain John F. Kennedy en 1961), l'épreuve de force se poursuivit (répression de l'insurrection hongroise par les chars russes en 1956, érection du mur de Berlin en 1961) et en 1962, la tension américano-soviétique atteignit son paroxysme avec la crise de Cuba qui fit craindre à tous un affrontement nucléaire généralisé. À cette date-là, la coexistence pacifique cessa d'apparaître comme un thème ou un argument de propagande, et il devint évident qu'elle était une nécessité qu'il fallait absolument traduire dans les faits.
2.4. Les conséquences de la rupture sino-soviétique (1962)
Un autre événement survint alors : la rupture sino-soviétique, entamée dès la fin des années 1950 et portée sur le devant de la scène internationale en 1962. Cette question était d'autant plus préoccupante pour les Soviétiques que, le 16 octobre 1964, les Chinois avaient fait éclater leur première bombe atomique (fabriquée sans l'aide de l'URSS). Craignant que les Chinois ne fassent usage d'une arme nucléaire sur laquelle ils n'exerceraient aucun contrôle, les Soviétiques préférèrent s'entendre avec leurs ennemis – les Américains –, plutôt que de traiter avec la Chine, ce qui aurait risqué de bouleverser l'équilibre entre les deux superpuissances.
2.5. Doctrine transitoire ou nouveau partage du monde ?
Mais, pour les dirigeants du Kremlin, cette nouvelle politique soumise à une logique nucléaire ne devait pas, à terme, mener à la réconciliation avec le camp adverse. L'URSS ne renonçait ni à sa lutte contre le système capitaliste ni à l'expansion de sa sphère d'influence. La coexistence pacifique n'était pas la paix, mais une doctrine transitoire dictée par les circonstances du moment : c'était la poursuite de la guerre froide sous une autre forme. Les Américains, en revanche, percevaient la coexistence pacifique comme une nouvelle forme de partage du monde dans la continuité de Yalta , chaque pays restant maître dans la sphère d'influence qui était la sienne.
3. Les aspects de la coexistence pacifique : la détente (1962-1975)
Après la crise de Cuba, les relations américano-soviétiques s'améliorèrent. Dès juin 1963, un « téléphone rouge » fut instauré entre la Maison Blanche et le Kremlin, permettant aux deux Grands de maintenir un lien permanent afin d'éviter le déclenchement d'une guerre nucléaire par « accident ». Les deux Grands signèrent par la suite toute une série d'accords stratégiques et militaires visant à limiter la course aux armements, ainsi que d'autres concernant les domaines politiques et économiques. Cette nouvelle phase des relations internationales qui succède à la guerre froide est appelée « la détente ».
3.1. Les accords de désarmement
Les accords de moscou (1963).
Les accords de Moscou signés le 5 août 1963 par les ministres des Affaires étrangères de l'Union soviétique, du Royaume-Uni et des États-Unis furent les premiers à proscrire les essais nucléaires (à l'exception cependant des essais souterrains).
Le traité de non-prolifération nucléaire (1968)

Ils furent suivis par un traité de non-prolifération (TNP) des armes nucléaires (1968) qui interdisait aux détenteurs de l'arme nucléaire de fournir à quelqu'État que ce soit des armes de ce type, des composantes ou des matières premières permettant d'en construire, ou d'inciter les États qui n'en n'étaient pas dotés à en fabriquer. Ces derniers s'engageaient, de leur côté, à ne pas chercher à produire ou à acquérir ces armes. Le traité favorisait également le développement du nucléaire civil. Il ne fut signé ni par la France, ni par la Chine, ni par l'Inde.
Les accords SALT I (1972) et SALT II (1979)
Les accords SALT (Strategic Arms Limitations Talks) furent conclus le 26 mai 1972 par Richard Nixon et Leonid Brejnev dans un tout autre contexte. En raison des progrès considérables de la technologie – telle la mise au point des missiles anti-missiles et des missiles à tête multiple (les MIRV, Multiple Independently Targeted Return Vehicle ) –, la préoccupation principale des négociateurs fut de limiter l'armement stratégique.
Le fait que l'apparition de nouvelles armes n'entraint pas dans les catégories définies par SALT I conduisit les dirigeants soviétiques et américains à ouvrir de nouvelles négociations en 1973. Elles aboutirent en 1979 à la signature des accords SALT II, que le Sénat américain refusa de ratifier, en raison notamment de l'invasion de l'Afghanistan par les troupes soviétiques.
3.2. Les accords politiques et commerciaux
L'ostpolitik (1970-1973).

En Europe, la coexistence pacifique se manifesta par la politique d'ouverture à l'Est, l’ Ostpolitik , menée par le chancelier allemand Willy Brandt : en 1970, Bonn concluait avec l'URSS, puis avec la Pologne, des traités qui reconnaissaient définitivement la ligne Oder-Neisse comme frontière occidentale de la Pologne. En 1972, le traité fondamental organisait les relations entre la RFA et la RDA : les deux États se reconnaissaient mutuellement et échangeaient des représentations diplomatiques permanentes. L'année suivante, les deux Allemagnes étaient admises simultanément à l' ONU .
Le rapprochement sino-américain (1971-1972)
En Asie, la détente permit le rapprochement entre Pékin et Washington. En 1971, la Chine populaire entra à l'ONU et, l'année suivante, le président américain Richard Nixon se rendit en Chine.
Les accords d'Helsinki (1975)
Mais c'est en 1975, avec les accords d'Helsinki, que la détente atteignit son apogée. Signés à l'issue de la première session de la Conférence pour la Sécurité et la Coopération en Europe (CSCE) par 35 pays dont l'URSS, les États-Unis, le Canada et tous les États européens (à l'exception de l'Albanie), ces accords reconnaissaient l'inviolabilité des frontières des États participants ainsi que leur intégrité territoriale.
Les signataires s'engageaient également à respecter les droits de l'homme et les libertés fondamentales, à développer la coopération, surtout dans les domaines de l'économie, de la science et de la technique, de l'environnement, de l'aide humanitaire, de la culture et de l'éducation.
Les accords commerciaux
Cette entente fut complétée par des accords commerciaux entre l'Est et l'Ouest, notamment entre les États-Unis et l'URSS : le commerce entre les deux pays décupla entre 1970 et 1975, les États-Unis livrant des céréales et des produits industriels non stratégiques, l'URSS, du pétrole. Quant aux autres pays du bloc communiste, ils bénéficièrent de crédits provenant des pays occidentaux.
4. Les limites de la coexistence pacifique et la fin de la détente
4.1. les conflits périphériques.
Toutefois, malgré cette très nette amélioration des relations entre les deux blocs, de nouveaux conflits vinrent alimenter les tensions : guerre du Viêt Nam (1964-1973) en Asie du Sud-Est, guerres des Six-Jours (1967) et du Kippour (1973) au Proche-Orient (→ guerres israélo-arabes ).
Parallèlement, l'URSS maintenait fermement son emprise sur sa sphère d'influence en Europe : en 1968, elle envoya les forces du pacte de Varsovie à Prague (Tchécoslovaquie) pour mettre fin au régime libéral d' Alexander Dubček ; elle appliquait ainsi sa doctrine de la « souveraineté limitée » qui justifiait une intervention armée dans le bloc soviétique si le communisme y était menacé.
Les intérêts des deux Grands s'opposèrent également au Cachemire (1965-1966) et au Bangladesh (1971).
4.2. Le retour à la guerre froide
Mais ce fut surtout à partir de 1979 que les rapports américano-soviétiques se dégradèrent, du fait, d'une part, de l'installation par les Américains de fusées Pershing et de missiles de croisière en Europe occidentale et, d'autre part, de l'invasion de l'Afghanistan – pays qui n'appartenait pas au pacte de Varsovie – par les Soviétiques. C'était la fin de la détente et le retour de la guerre froide.
4.3. Bilan de la coexistence pacifique
Les profits retirés de la coexistence pacifique par les États-Unis furent sans doute moins importants que ceux retirés par l'URSS.
Pour l'URSS
En effet, tout en renforçant son arsenal stratégique et en bénéficiant des apports technologiques et commerciaux de l'Ouest, l'URSS développait son économie, étendait sa sphère d'influence dans le tiers-monde et soutenait les mouvements contestataires occidentaux. Les objectifs de l'URSS restaient les mêmes – lutte contre le capitalisme et exportation du communisme –, la stratégie, seule, avait changé. Il s'agissait d'éviter que n'éclate une Troisième Guerre mondiale.
Pour les Occidentaux
Ces déséquilibres, qui s'accrurent au cours des années 1970, conduisirent un certain nombre d'Occidentaux à se méfier de la stratégie russe et à la percevoir finalement comme un marché de dupes.
Médias associés

- S’abonner
1963-1964 : la coexistence pacifique et le basculement des périphéries

Abonnez-vous pour télécharger cet article en format PDF
Comment expliquer un tournant ? Pour y voir clair sur les macro-crises, il faut parfois augmenter l’échelle d’analyse — jusqu’à celle de la fin d’année. Pour nous aider à passer de 2023 à 2024, nous avons demandé à Pierre Grosser de commissionner 10 textes, un par décennie, pour étudier et mettre en contexte des tournants plus amples. Après cinq épisodes sur 1913-1914 , 1923-1924 , 1933-1934 , 1943-1944 et 1953-1954 , voici le sixième sur la fin de la coexistence pacifique, en 1963-1964.
Découvrez nos autres séries de 2023 — de Stratégies à Oppenheimer en passant par Kaboul — et profitez des fêtes pour vous abonner ou offrir le Grand Continent .
La première moitié de l’année 1963 laissait présager un âge d’or de la coexistence pacifique. Après avoir frôlé la guerre nucléaire avec la crise des missiles à Cuba l’année précédente, les superpuissances américaine et soviétique saisirent l’importance d’établir des communications fiables. Pour ne plus passer par des messagers interposés et de longs processus de décryptage, Washington et Moscou établirent une ligne directe en juin 1963 et conclurent quelques semaines plus tard, le 5 août 1963, un traité interdisant partiellement les essais d’armes nucléaires. À toute heure, Washington et Moscou s’échangeaient des messages par un téléscripteur, plus connu sous le nom trompeur de « téléphone rouge ». Le monde pouvait donc être assuré qu’une guerre nucléaire n’allait pas être déclenchée par un simple malentendu.
L’assassinat d’un chef d’État vint perturber cette stabilité apparente pour faire à nouveau basculer la Guerre froide dans une escalade de violence. Immédiatement, le meurtre du président américain, John Fitzgerald Kennedy, commis le 22 novembre 1963, alors que le cortège présidentiel parcourait les rues de Dallas au Texas, vient à l’esprit. La mort tragique du plus jeune président américain jamais élu constitue un véritable tournant de la Guerre froide. Comme le note l’historien Fredrik Logevall, les États-Unis entrèrent dans le « long 1964 », une période s’étirant entre août 1963 et la fin de février 1965, lorsque Washington annonça intervenir directement au Sud Vietnam 1 . Au fil de cette période d’incertitude, le nouveau président, Lyndon Baines Johnson, déterminé à protéger sa réputation et mettre en œuvre de grands chantiers dans la santé, l’éducation ou contre la pauvreté, ne voulut pas se laisser dépasser par les événements au Vietnam. Convaincu qu’il devait établir sa crédibilité en politique extérieure pour mieux réaliser sa vision en politique intérieure, Johnson dut convaincre le Congrès américain de la menace que constituait Hanoi, se faire élire et enfin annoncer une intervention armée au Vietnam. Ce fut au long de cette période que Johnson s’assura d’avoir toutes les cartes en main pour la entrer en guerre.
L’assassinat de John Fitzgerald Kennedy constitue un véritable tournant de la Guerre froide. Phi-Vân Nguyen
Cependant, si l’on prend un point de vue plus global, l’assassinat de Ngô Đình Diệm, président de la République du Vietnam (RVN) trois semaines plus tôt, reflète encore mieux les mutations que traversaient alors la guerre froide. La coexistence pacifique et son maintien par une ligne de communication directe découlait du principe qu’il existait deux blocs menés par Moscou et Washington. Cependant, la manière dont la situation dégénéra au Sud Vietnam et engagea de multiples acteurs à travers le monde nous montre qu’en réalité, cette organisation bipolaire ne reflétait pas la réalité. Dans le camp communiste, le leadership de Moscou n’était plus représentatif car Hanoi voulait reprendre la lutte et le chaos régnant dans le sud le convainquit de redoubler de détermination. La Chine, malgré les revers connus par le Grand bond en avant, poursuivit ses ambitions de devenir une puissance nucléaire et d’éveiller des rébellions maoïstes. Le camp occidental n’était pas plus uni car plusieurs acteurs voulurent approfondir la coexistence pacifique pour neutraliser le conflit au Vietnam, une initiative que plusieurs pays afro-asiatiques vinrent soutenir. Les deux superpuissances constatèrent avec inquiétude cette déstabilisation venant de leur périphérie. Alors que l’Union soviétique traversait une crise pour remplacer Nikita Krouchtchev, les États-Unis qui connaissaient également un moment de transition, firent le choix d’intervenir de manière directe et indirecte en dehors de leurs frontières pour enrayer tout développement qui irait à l’encontre de leurs intérêts. Bien que cette politique proactive ait commencé sous Kennedy, Johnson orienta plus nettement la politique américaine dans une direction interventionniste. Le déploiement de l’armée américaine au Vietnam en mars 1965 confirma la fin de la coexistence pacifique et accéléra le fractionnement, en amenant un nombre toujours plus grand d’acteurs du bloc occidental à remettre en question cette évolution.

Le Sud Vietnam, épicentre des tensions locales et internationales
Saigon connaissait depuis 1959 un conflit armé mené par des insurgés regroupés sous l’étendard du Front de libération national (FLN), créé par Hanoi. Kennedy augmenta en conséquence le nombre de forces spéciales et de conseillers, faisant passer le personnel militaire américain d’environ 3000 en 1961 à plus de 11000 à la fin de l’année 1962 pour encadrer une armée sud-vietnamienne d’environ 200 000 hommes. Le Viêt Nam du Sud avait bien mis en place des hameaux stratégiques, isolant la population paysanne des insurgés. Mais Saigon connut un revers humiliant. En janvier 1963, 350 combattants du FLN réussirent à infliger une défaite à des unités sud-vietnamiennes accompagnées de leurs conseillers américains. Même l’équipement de haute technologie, comme les hélicoptères américains, qui étaient censés faciliter les opérations de contre-insurrection, n’avaient pas aidé. Des journalistes américains, Neil Sheehan et David Halberstam, décrivirent la bataille de Ap Bac comme une véritable débâcle, alertant le public américain qui pensait auparavant que le communisme ne pouvait pas se propager jusqu’au Sud. Saigon, en dépit de toute l’aide américaine, ne parvenait pas à endiguer l’expansion du communisme.
Le déploiement de l’armée américaine au Vietnam en mars 1965 confirma la fin de la coexistence pacifique et accéléra le fractionnement, en amenant un nombre toujours plus grand d’acteurs du bloc occidental à remettre en question cette évolution. Phi-Vân Nguyen
Le mécontentement dans les villes vint également ébranler la légitimité de Ngo Dinh Diem, le président du Viêt Nam du Sud. Celui qu’en 1955, la presse avait nommé « America’s Miracle Man » pour avoir recueilli des réfugiés quittant le Nord Vietnam, triomphé de ses opposants politiques et constitué un bastion face à la menace communiste, apparut sous un nouveau jour. Les limites qu’il imposa aux libertés démocratiques renforcèrent le sentiment qu’il était devenu un dictateur entretenu par l’aide américaine. Au cœur du problème se trouvait la très grande influence dont les catholiques jouissaient au sein du régime alors qu’ils ne comptaient que pour dix pour cent de la population. Le Président lui-même était issu d’une ancienne famille catholique du centre du pays. Des militants bouddhistes basés dans le centre, à Hué, et politisés par des contacts avec des activistes ceylanais, s’opposèrent ouvertement au gouvernement. Selon eux, une minorité religieuse imposait son autorité sur une majorité bouddhiste.
En mai 1963, la célébration du Vesak, l’anniversaire de la naissance de Bouddha, dégénéra lorsque les autorités locales de Hué interdirent l’usage du drapeau bouddhiste. Dès lors, des manifestations bouddhistes se multiplièrent dans les villes principales. Le gouvernement s’obstina à minimiser ces revendications en les présentant comme le signe d’une infiltration communiste et réprima sévèrement les manifestants. Cette crise devint critique pour Saigon lorsque des correspondants étrangers furent témoins de la détermination bouddhiste. La photographie du moine Thich Quang Duc, s’immolant par le feu à un carrefour de Saigon, fit la une des journaux, décrocha le prix World Press de 1963 et le Pulitzer l’année suivante. Aux yeux du monde entier, Ngo Dinh Diem était devenu un véritable despote.
Dès lors, les affaires sud-vietnamiennes devinrent une préoccupation quotidienne pour Washington et les relations entre les deux pays se compliquèrent depuis le remplacement de son ambassadeur à Saigon, Frederick Nolting, un fervent partisan de Ngo Dinh Diem, par Henry Cabot Lodge, un républicain nettement plus distant du président sud-vietnamien. Ainsi, lorsqu’un groupe d’officiers s’attaqua au Palais de l’indépendance où résidait le président le 1 er novembre 1963, Ngo Dinh Diem et son frère Ngo Dinh Nhu prirent la fuite mais tous se doutaient qu’ils ne pouvaient pas espérer la protection des Américains. L’armée les retrouva dans une église de Cho Lon, la ville chinoise adjacente à Saigon et ils furent assassinés alors qu’ils étaient reconduits aux quartiers généraux de l’armée.
Le renversement de Diem laissa un vide politique que personne ne sut combler. Dans les mois qui suivirent, le Sud Vietnam connut quatre coups d’État et huit cabinets se succédèrent pour diriger le pays. Cette valse des gouvernements ne reflétait pas seulement le rôle croissant de l’armée dans la direction des affaires, elle résultait également d’une vague de manifestations qui secouait les principales villes du pays. D’un côté, des manifestants bouddhistes considéraient être les meneurs de la Révolution du 1 er novembre et ils refusaient que les membres du nouveau gouvernement puissent être reliés à l’ancien régime, à la religion ou à la région d’origine de l’ancien président. De l’autre, des partisans de l’ancien régime et des catholiques, se mobilisèrent pour que cette Révolution renverse Ngo Dinh Diem sans les faire passer pour des réactionnaires. En d’autres termes, Saigon était paralysée et la population des villes sud-vietnamiennes s’entre-déchirait, entre Révolution et contre-révolution, un processus dont il fallait encore déterminer la teneur, l’étendue et sa direction par rapport à la guerre.

Le réveil des rébellions maoïstes
Le parti des travailleurs vietnamiens profita du chaos politique paralysant le Sud Vietnam. En janvier 1964, l’armée sud-vietnamienne connut un autre revers, encore plus cinglant. Le FLN prit le dessus sur certaines de ses unités d’élites dans une région, Binh Gia, au Sud-Est de Saigon, où la plupart des villages, peuplés de réfugiés catholiques du Nord, leur étaient hostiles. Les forces armées du FLN, même éloignées de leur terroir naturel, pouvaient tenir tête à l’armée. Cette avancée reflétait la détermination du parti à poursuivre la lutte armée.
Une nouvelle direction commença par l’ascension d’un communiste originaire du sud, Le Duan, au poste de secrétaire général dès 1960, mais devint officielle lors du 9 e Plénum du parti des travailleurs vietnamiens en décembre 1963 2 . Le parti ajusta tout d’abord son positionnement vis-à-vis du bloc communiste. Les tensions entre Moscou et Pékin n’avaient cessé de s’intensifier. Les dirigeants soviétiques désapprouvèrent le Grand bond en avant et pensaient que Mao se trompait lamentablement s’il pensait pouvoir accélérer les stades de développement du capitalisme analysés par Karl Marx. Mao, de son côté, considérait le dénouement de la crise de Cuba comme un véritable échec. Pour Mao, le retrait des missiles montrait non seulement que l’Union soviétique était devenue révisionniste, mais qu’il existait un vide dans le leadership de la révolution du tiers-monde que la Chine pouvait combler. Cet écart grandissant entre les deux géants eut un impact évident sur les Vietnamiens et la reprise de leur lutte pour unifier le pays.
Le parti des travailleurs vietnamien ne renia jamais ouvertement le leadership de Moscou, mais il se détourna de sa ligne générale et se permit même de critiquer de manière détournée l’Union soviétique. Une revue publia une série d’articles taxant Tito de révisionnisme pour avoir abandonné la collectivisation des terres. Elle qualifia également le traité d’interdiction partielle des essais nucléaires signé par Moscou et Washington en août 1963, d’une manœuvre des « impérialistes américains », sous-entendant que les leaders soviétiques s’étaient fait berner. De l’autre côté, les communistes vietnamiens se rapprochèrent de la ligne chinoise. La visite de Liu Shiaoqi à Hanoi en mai 1963 réaffirma la détermination de la Chine de venir à l’aide de son voisin en cas d’attaque américaine. Avant cette visite, Le Duan avait instillé dans le parti la volonté de parvenir à l’autosuffisance économique en développant l’industrie pour combler les besoins économiques du pays une fois réunifié parce qu’il n’était pas réaliste de se reposer entièrement sur la solidarité économique entre pays communistes puisque chacun d’entre eux connaissait des conditions distinctes.
Le parti communiste vietnamien adopta également une vision du monde résolument orientée vers un retour à la lutte, tant sur le plan national qu’au niveau mondial. Le Plénum vota une résolution visant la transformation d’un monde reposant sur l’exploitation des « antagonismes » qui se manifestaient non seulement sur les populations colonisées, mais aussi à l’intérieur des pays capitalistes. Ainsi la guerre au Vietnam devait inspirer une lutte mondiale et trouver des échos jusqu’aux États-Unis, au sein de la population afro-américaine par exemple. Le discours de Le Duan, prononcé lors du Plénum, assura la fidélité du Vietnam au bloc communiste et continua de reconnaître l’Union soviétique comme son leader. Mais il affirma par la même occasion sa volonté de reprendre la lutte.
Pour le parti communiste vietnamien, la guerre devait inspirer une lutte mondiale et trouver des échos jusqu’aux États-Unis, au sein de la population afro-américaine par exemple. Phi-Vân Nguyen
Pour Pékin, cette prise de position officielle pour une lutte menée par les Vietnamiens vint confirmer l’idée que la Chine devait devenir le nouveau leader du monde asiatique, africain et latino-américain. Pékin sortait à peine de la famine causée par le Grand bond en avant. Malgré cela, la Chine prit une posture agressive en affirmant à nouveau en 1964 ses engagements sur la protection du Nord Vietnam et en fournissant immédiatement l’aide demandée par les communistes laotiens. De plus, l’essai atomique réussi en octobre 1964 montrait que Pékin n’avait pas abandonné son désir de maîtriser l’arme nucléaire. Après le Royaume-Uni et la France dans le bloc occidental, l’accession de la Chine au rang de puissance nucléaire ajoutait un bien plus grand degré d’incertitude car Pékin se montrait bien plus agressif et prêt à remettre en question le leadership communiste de l’Union soviétique. En fait, les ambitions chinoises dépassaient de très loin la péninsule indochinoise 3 . Mais pour l’heure, un combat armé mené par des communistes vietnamiens lui permettait d’éviter une confrontation directe avec les Américains. Le projet chinois de mener une révolution mondiale se matérialisait principalement par le soutien donné aux Vietnamiens, mais l’ambition ultime du géant chinois n’était plus un secret. Tout ceci, évidemment, rajouta aux angoisses grandissantes de Moscou, qui s’inquiétait de plus en plus de Pékin et qui aurait préféré préserver la coexistence pacifique, alors qu’elle traversait une crise dans la succession de Krouchtchev. Ce fut justement par crainte d’une déferlante de rébellions maoïstes que d’autres tensions escaladèrent en véritables conflits en perturbant, cette fois, d’autres processus de décolonisation.
La proclamation de la Fédération de Malaisie en septembre 1963, provoqua une période de confrontation ( Konfrontasi ) occasionnant des combats de frontières avec la République d’Indonésie voisine 4 . Jakarta rêvait d’agrandir son territoire pour réaliser une Grande Indonésie, rassemblant tous les Malais de l’archipel et de la péninsule dans un même état. Or, la décision britannique de rassembler Bornéo, Sarawak et Singapour dans une Fédération des États malais apparut aux yeux de Sukarno comme une manœuvre pour limiter les ambitions régionales de l’Indonésie. Aussitôt la Fédération proclamée, des affrontements armés se produisirent le long de la frontière, opposant l’armée indonésienne aux forces malaisiennes et aux troupes du Commonwealth. Il est vrai que la Chine rencontra des représentants communistes vietnamiens, laotiens et indonésiens à deux reprises en 1963 et 1964. Mais les représentations malaisiennes exagérèrent la nature maoïste du conflit. De plus, elles donnèrent l’impression que le parti communiste indonésien, le PKI, avait pris trop d’importance dans le pays et que Sukarno penchait trop clairement du côté de Pékin, alors qu’il gardait en réalité ses distances. Le départ de l’Indonésie de l’ONU lorsque la Fédération de Malaisie y fût admise avec le soutien des États-Unis en janvier 1965 vint officialiser sur la scène publique, l’opposition indonésienne à un système international qu’il considérait être à la solde des Américains. Neuf mois plus tard, une faction de l’armée renversa Sukarno et élimina près d’un demi million de membres du PKI dans un génocide dans lequel les États-Unis, le Royaume-Uni et l’Australie eurent leur part de complicité selon une décision du tribunal de la Haye en 2016. La propagation réelle ou imaginée des rébellions maoïstes contribua indéniablement à la fin de la coexistence pacifique et ce, même dans d’autres conflits qui n’étaient pas directement reliés à la guerre froide.

Une neutralisation selon les termes du tiers-monde
Le durcissement de la guerre froide fut aussi une réaction aux diverses tentatives des pays afro-asiatiques d’influencer les relations internationales par leur vision. En effet, la littérature récente a mis en évidence l’importance de considérer le tiers-monde, non pas comme un espace qu’il faudrait comprendre par la négative, parce qu’il ne ferait partie ni du bloc capitaliste ni du bloc communiste, mais comme un projet mené par des pays afro-asiatiques pour constituer un contrepoids aux superpuissances. Ce fut d’abord dans les institutions de l’ONU, en particulier dans l’Assemblée générale, que cet ensemble tenta d’exercer son influence. Une de leur plus grande réussite fut l’intervention de l’ONU dans l’indépendance de l’Indonésie mais la possibilité d’un véritable bloc afro-asiatique s’effondra après la guerre sino-indienne de 1962 5 . Malgré cela et justement pour contrebalancer la Chine et son appétit pour les rébellions armées, plusieurs pays afro-asiatiques tentèrent d’influencer l’issue de conflits comme celui du Vietnam.
La propagation réelle ou imaginée des rébellions maoïstes contribua indéniablement à la fin de la coexistence pacifique. Phi-Vân Nguyen
En fait, ces pays afro-asiatiques jouèrent un rôle dans le tournant de 1963 dans le Sud Vietnam. En effet, lorsque la crise bouddhiste ébranla le gouvernement de Ngo Dinh Diem, quatorze États de l’Assemblée générale, tous issus du tiers-monde, demandèrent la création d’une commission d’enquête sur « la violation des droits de l’homme au Sud Vietnam » en septembre 1963. Recevant une réponse positive de Saigon, l’Assemblée générale envoya une délégation dont la mission fut d’établir les faits concernant les diverses allégations de violation des droits de l’homme 6 . Les délégués commencèrent leur travail le 24 octobre 1963, s’entretenant avec plusieurs personnalités et pensant pouvoir conclure leur travail avant le 3 novembre. Leur présence venait confirmer la gravité de la situation pour le Sud Vietnam et aux yeux du monde. Cependant, le coup d’État du 1 er novembre interrompit brusquement leur enquête. En raison des combats dans la ville, les délégués restèrent confinés à l’hôtel Majestic jusqu’à ce qu’ils soient escortés à l’aéroport pour quitter le pays, à la date prévue du 3 novembre. Cette enquête est souvent mentionnée de manière anecdotique dans les histoires de la guerre du Vietnam. Pourtant, l’échec de cette commission eut une signification plus importante. La Déclaration universelle des droits de l’homme adoptée en 1948 n’avait jamais été formulée pour avoir une force contraignante sur ses états. Cependant, rien n’empêchait l’Assemblée générale d’utiliser ce texte comme un standard auquel tout État aspirant à être membre de l’ONU devait se conformer. L’échec de la commission d’enquête mit un terme assez net à l’utilisation des droits de l’homme comme un outil pour mieux surveiller les actions des États. Elle montrait d’ailleurs aux pays afro-asiatiques, que la voie de l’ONU comportait de sérieuses limites. Outre le véto parfois infranchissable des membres permanents du Conseil de Sécurité, les circonstances locales pouvaient elles aussi couper court aux initiatives de la voie onusienne.
Ce fut possiblement pour cette raison que ces pays afro-asiatiques tentèrent une autre voie multilatérale pour neutraliser la guerre au Vietnam. Une opportunité se présentait avec la conférence afro-asiatique prévue en Algérie en 1965 qui prévoyait la possibilité que Hanoi et Saigon puissent tenir des pourparlers. Dans cette succession de gouvernements sud-vietnamiens, le cabinet Phan Huy Quat bénéficiait d’une grande marge de manœuvre car il fut nommé par le général Nguyen Khanh juste avant que celui-ci ne soit chassé du pouvoir. Ce nouveau cabinet s’inquiétait d’une escalade incontrôlée de la guerre. En effet, quelques jours plus tôt le gouvernement américain avait fait débarquer ses troupes à Danang sans même avertir le nouveau gouvernement. Phan Huy Quat et son équipe pensaient donc qu’une neutralisation pouvait peut-être servir les intérêts vietnamiens.
La conférence fut repoussée pour des raisons logistiques. Elle butta aussi sur la question de savoir si l’Union soviétique pouvait en faire partie en tant que grande puissance asiatique, chose que la Chine refusait catégoriquement, mais que les pays organisateurs considéraient sérieusement pour faire montre d’indépendance vis-à-vis de Pékin. En définitive, la conférence n’eut jamais lieu. Des membres de l’armée renversèrent le gouvernement algérien de Ben Bella et avec lui, le projet d’accueillir un tel forum. Mais la tentative des pays afro-asiatiques de neutraliser le conflit vietnamien avaient été tentée et la possibilité que Saigon se joignît à la discussion, renforçait ses chances d’aboutir à un cessez-le-feu.

Un bloc occidental désuni
Ces initiatives de neutralisation eurent d’autant plus de chances de réussir qu’une partie du monde occidental pensait également que la coexistence pacifique devait être renforcée et non pas abandonnée. Cette volonté affaiblissait le rôle des États-Unis, comme leader du bloc occidental et contribua à l’effritement de sa puissance. C’est sous cet angle qu’il faut comprendre les gestes de l’Église catholique qui avait pendant si longtemps soutenu les efforts américains de contrer l’expansion du communisme. Face à un processus de décolonisation qui risquait de la faire chasser de plusieurs pays de mission, elle devait revoir sa position dans un monde où les empires coloniaux s’effondraient un à un. En effet, plusieurs mouvements d’indépendance n’avaient que peu de sympathie pour une institution qui s’était souvent développée sous la protection de l’État colonial. En Algérie par exemple, la guerre amena l’archevêque à remettre plusieurs propriétés au nouvel État indépendant et d’accepter d’être une église qui ne cherchait plus à propager sa foi.
Cette nouvelle position se concrétisa dans le Second Concile œcuménique tenu entre 1962 et 1965 et dont l’objectif était de mettre à jour la position de l’Église face aux circonstances du monde moderne. Mais cette adaptation s’appliquait également à la coexistence pacifique. L’encyclique Pacem in terris du pape Jean XXIII diffusée en avril 1963, appela tous les hommes de bonne foi à faire cesser la prolifération des armes nucléaires et à protéger la paix. Les papes suivants poursuivirent cette politique, en ouvrant les relations avec la Pologne et en accueillant avec bienveillance l’annonce de Hanoi de tenir une trêve pour Noël en 1965. Le monde catholique se rapprochait de plus en plus des autres chrétiens dans leur revendication pacifique et cela permit, au cours des années suivantes, à plusieurs membres de l’Église — parfois contre la volonté de leur hiérarchie — de s’opposer à la guerre au Vietnam.
Face à un processus de décolonisation qui risquait de faire chasser l’Église catholique de plusieurs pays de mission, celle-ci devait revoir sa position dans un monde où les empires coloniaux s’effondraient un à un. Phi-Vân Nguyen
D’autres acteurs comprirent que la coexistence pacifique permettait de sortir d’un monde strictement bipolaire. Le premier à sauter sur cette opportunité fut Charles de Gaulle qui voulait profiter de la rupture sino-soviétique et de la mobilisation de plusieurs pays du tiers-monde pour marquer une plus grande indépendance vis-à-vis du géant américain 7 . Après avoir conclu la guerre d’Algérie par les Accords d’Evian en 1962, le général se tourna vers le Vietnam. Il avait soumis, sans succès, l’idée d’une neutralisation du pays aux États-Unis. Mais de Gaulle revint à la charge en proposant dès le mois de décembre 1963 un plan en trois points pour un cessez-le-feu au Vietnam. En janvier 1964, la reconnaissance de la République populaire de Chine marqua un pas supplémentaire dans ce rapprochement vers le tiers-monde. Plusieurs Sud-vietnamiens, en partie parmi ceux qui désiraient le plus mener une guerre contre le communisme, protestèrent face à l’interférence de l’ancienne puissance coloniale. Mais de Gaulle poursuivit sa politique et se rapprocha de l’ex-roi Norodom Sihanouk, qui avait préconisé un neutralisme pendant des années, mais qui refusa toute aide américaine au Cambodge en novembre 1963. Ce fut d’ailleurs à Phnom Penh que le général prononça un discours pour soutenir le « droit des peuples à disposer d’eux-mêmes » en septembre 1966. La France, elle aussi, participa en partie à ce basculement en renforçant les appels du tiers-monde pour poursuivre la coexistence pacifique.

Escalade et radicalisation
C’est dans ce contexte de rivalité sino-soviétique, de reprise des combats, de mobilisation du tiers-monde et de désunion du bloc occidental, qu’il faut comprendre le « long 1964 » américain. Lyndon B. Johnson eut l’opportunité, à plusieurs reprises, de neutraliser la guerre et de protéger la coexistence pacifique. Mais l’intensification du conflit et le chaos politique au Vietnam l’amenèrent à choisir l’intervention et à prendre une approche plus méfiante vis-à-vis d’un tiers-monde que Kennedy avait pourtant tenté de coopter 8 . En août 1964, Washington annonça au congrès que des navires américains avaient été attaqués par des torpilles nord-vietnamiennes et obtint la résolution du Golfe du Tonkin qui donna au président le droit de prendre « toutes les mesures nécessaires, y compris l’usage de la force pour venir en aide à un état signataire ou protocolaire du traité de défense collective de l’Asie du sud-est ». Après avoir été dûment élu en novembre 1964, Johnson sortit les États-Unis de la réserve qui s’imposait par la coexistence pacifique.
La guerre au Vietnam fut la manifestation la plus visible, d’une politique d’anticipation et de réaction, que Kennedy avait mise en œuvre peu après la révolution cubaine en Amérique centrale et latine. Chaque développement pouvant aller à l’encontre des intérêts géopolitiques américains devait être neutralisé. Ainsi, en avril 1963, les États-Unis encouragèrent un coup au Guatemala qui bloqua le retour au pouvoir de Juan José Arévalo. Washington savait que l’ex-président qui se présentait à nouveau pour la campagne de 1963, n’était pas un communiste. Mais il tenait des propos parfois trop anti-américains et favorisait des mesures sociales qui pouvaient affecter les intérêts des États-Unis. Johnson fit le même choix au Brésil. Les politiques considérées gauchistes du président Goulart, amenèrent les généraux à passer à l’action le 31 mars 1964 reversant la Quatrième république, sous la bénédiction de Washington. Les États-Unis renforcèrent également leur aide à Edouardo Frei pour empêcher la victoire du socialiste Salvador Allende aux élections chiliennes de septembre 1964.
La guerre au Vietnam fut la manifestation la plus visible, d’une politique d’anticipation et de réaction, que Kennedy avait mise en œuvre peu après la révolution cubaine en Amérique centrale et latine. Phi-Vân Nguyen
À la fin février 1965, Johnson annonça sa volonté d’intervenir directement au Vietnam. Cela se manifesta, quelques jours plus tard, par une campagne de bombardement massif, puis un débarquement de troupes au sol. Une autre intervention armée amena les États-Unis en République dominicaine, en juin 1965, dans le but de prévenir une autre révolution similaire à celle de Cuba, mais s’exposa aussitôt à la critique. La légalité d’une telle intervention, déjà soulevée lors du débarquement de la baie des Cochons en avril 1961 montrait que Washington avait peu d’égards pour le droit international. Plusieurs développements perçus de manière défavorable par Washington, la reprise de la lutte au Sud Vietnam, la radicalisation de la Chine, plusieurs conflits ou mouvements politiques considérés trop à gauche, amenèrent Washington à encourager des renversements ou soutenir des leaders politiques donnant l’impression d’une contre-révolution à l’échelle mondiale en 1964 et en 1965. Mais sa manifestation la plus claire et durable de cette nouvelle politique américaine se trouvait dans son intervention au Vietnam. Avec des États-Unis prêts à déployer ses troupes aussi loin de ses frontières, la guerre froide avait résolument basculé de la coexistence pacifique vers une escalade des tensions.
- Fredrik Logevall, Choosing War : The Lost Change for Peace and the Escalation of War in Vietnam , Berkeley, University of California Press, 1999.
- Pierre Asselin, Vietnam’s American War , Cambridge, Cambridge University Press, 2018, p. 99-110. Tuong Vu, Vietnam’s Communist Revolution : The Power and Limits of Ideology , Cambridge, Cambridge University Press, 2017, p. 158-177.
- Jian Chen, Mao’s China & The Cold War , Chapel Hill, University of North Carolina Press, 2001.
- Ang Cheng Guan, Southeast Asia’s Cold War : An Interpretive History , Honolulu, Hawai’i University Press, 2018.
- Lorenz Lüthi, Cold Wars : Asia, the Middle East, Europe , Cambridge, Cambridge University Press, 2020, chapitre 11.
- La délégation se composait de représentants de l’Afghanistan, Brésil, Ceylan, Costa Rica, Dahomey, Maroc et Népal.
- Frédéric Turpin, De Gaulle, les gaullistes et l’Indochine , Paris, Les Indes savantes, 2005. Pierre Journoud, De Gaulle et le Vietnam , Paris, Tallandier, 2011.
- Mark Atwood Lawrence, The End of Ambition : The United States and the Third World in the Vietnam Era , Princeton, Princeton University Press, 2021.
- Afriques Subsahariennes
- Asie Intermédiaire
- Asie Orientale
- Asie septentrionale
- Méditerranée
- Anthropologie
- Bulletins des élections de l'Union européenne
- Démographie
- Doctrines de la Chine de Xi Jinping
- Données qui changent la donne
- Énergie et environnement
- In Memoriam
- Santé publique
- Pièces de doctrines
- Perspectives sur l’actualité
- Archives et discours
- Comptes-rendus
- Histoire en images
- Informations légales
- Conditions générales de vente
Se connecter
Log in to your account
Pas encore de compte ? S’enregistrer
C’est parti
Créez votre compte
Vous avez déjà un compte ? Se connecter ici
Information importante
En raison d'une opération de maintenance, Moodle ULille ne sera pas accessible jeudi 26 août entre 12h30 et 13h30.
Activités du cours
Cours récents, informations du cours, droit international de la coexistence pacifique.

En 1945, le nouvel ordre mondial fondé par la Charte des Nations Unies entend faire de la paix le ‘bien’ juridique suprême, et mettre ainsi fin à la répétition historique. Il s’agit de « préserver les générations futures du fléau de la guerre qui deux fois en l’espace d’une vie humaine a infligé à l’humanité d’indicibles souffrances » (préambule de la Charte) ; une guerre totale , n’ayant épargné presqu’aucune population et caractérisée notamment par des violations graves du droit international humanitaire (bombardement de villes ouvertes, exécution de prisonniers, violences sexuelles, torture, entre autres), l’utilisation à deux reprises de la bombe atomique ainsi que l’entreprise d’extermination systématique d’environ six millions de Juifs en Europe (Holocauste). Les Alliés, vainqueurs de la Seconde guerre mondiale, décident par conséquent de faire de l’interdiction du recours à la force armée le principe fondateur – impératif ‑ de la nouvelle organisation mondiale et du multilatéralisme qu’elle institutionnalise, celui qui conditionne la réalisation de tous les autres droits (art. 2, §4, de la Charte). Et afin d’éviter l’impuissance passée de la Société des Nations, ils confient au Conseil de sécurité « la responsabilité principale du maintien de la paix et de la sécurité internationales » ainsi qu’un pouvoir de décision pour s’en acquitter. Cela dit, ils poursuivent aussi une ambition plus vaste puisqu’ils souhaitent « favoriser le progrès social et instaurer de meilleures conditions de vie dans une liberté plus grande » (préambule). La paix est par conséquent conçue lato sensu , de manière négative (éradication des guerres) et positive (création des conditions favorables à la coexistence pacifique des peuples), et de nombreuse branches du droit international sont mobilisées pour l’instaurer et la consolider.
Aujourd'hui, que reste-t-il du projet humaniste de coexistence pacifique de 1945 ? Comment le droit international a-t-il évolué pour tenter de servir au mieux cette grande vision d’un « monde commun » (au sens de P. Ricoeur) ? Comment le droit des Nations Unies résiste-t-il face aux multiples écueils qui guettent aujourd’hui le paradigme d’une paix mondiale conçue comme une normalité des relations internationales ‑ crise du multilatéralisme et des valeurs dites universelles, explosion du nombre de conflits armés non internationaux, retour éthique du recours à la force armée, instrumentalisation du droit international à des fins économiques, reconfiguration des relations humaines via les nouvelles technologies et l’intelligence artificielle, guerres ‘technologiques’, régionalisation et fragmentation des ordres juridiques, etc . ?. Autant de questions auxquelles ce cours général de droit international entend apporter des éléments de réponse, en analysant comment le droit international entend limiter l’expression de la violence au sein de la communauté internationale et garantir au mieux l’ordre public international émergent, puis de quelles façons il est mobilisé pour défendre la conception westphalienne de la société internationale, divisée en Etats souverains, contre les menaces existantes (faillite des Etats et terrorisme, par ex.), et tenter de mettre en place une protection des ‘communs’ (droits de l’homme, environnement, espaces maritimes, etc .).
- Enseignant: Muriel Ubéda-Saillard

IMAGES
VIDEO
COMMENTS
coexistence pacifique. Cet article fait partie du DOSSIER consacré à la guerre froide. Principe selon lequel deux États ou groupes d'États, aux idéologies opposées, acceptent de ne pas entrer en conflit armé. 2. Les causes de la coexistence pacifique. 2.1. L'impasse stratégique et militaire.
La coexistence pacifique. Le 5 mars 1953, Staline meurt. Il est remplacé par Nikita Khrouchtchev, qui condamne les crimes de Staline et permet la coexistence pacifique (1956) : les deux blocs ne s'affrontent plus qu'idéologiquement.
Exposée par le leader soviétique NIKITA KHROUCHTCHEV, la coexistence pacifique se définit comme une période de dégel et de rapprochement entre les Etats Unis et l'URSS tout en transformant leur lutte par une compétition pacifique sur les plans idéologique et économique. I-Les facteurs de la coexistence pacifique.
Article suivant: La détente (1962-1973) . les limites de la coexistence pacifique: Début de la coexistence : Entre les deux camps, Est-Ouest, la coexistence pacifique succède à la guerre froide. Dès la mort de Staline, s'était amorcé un dégel des relations, mais c'est surtout.
La coexistence pacifique : entre chaud et froid. Fiche de cours. Quiz. Profs en ligne. Videos. Application mobile. 1. Une méfiance qui reste vive. a. Le changement de contexte. On assiste à de véritables avancées dans le domaine international. C'est particulièrement vrai en 1954, avec la fin de la guerre d'Indochine.
COEXISTENCE PACIFIQUE. relations spécifiques. Entendue dans ce sens, la démocratie apparaît dans le monde moderne comme un dynamisme puissant qui commande notre situation d'hommes du xxe siècle. Or, depuis cinquante ans, deux formes de démocratie se trouvent affrontées.
La coexistence pacifique (1955-1962) Maurice Vaïsse. Dans Les relations internationales depuis 1945 (2019), pages 53 à 76. format_quote Citer ou exporter Ajouter à une liste. Chapitre. Plan. Auteur. Sur un sujet proche. Les années 1955-1956 ne sonnent pas la fin du monde bipolaire né au lendemain de la Seconde Guerre mondiale.
La coexistence pacifique : doctrine, illusion ou slogan. ? Jamais autant qu'aujourd'hui on n'a parlé de coexistence pacifique. L'expression, inventée par Staline bien avant la guerre, a gagné du terrain au point de figurer en bonne et due place dans la déclaration d'investiture de M. Michel Debré.
Texte intégral. COEXISTENCE PACIFIQUE ET GÉOSTRATÉGIE. par P. Célérier. Jamais sans doute le désir de vivre en paix et la crainte de la guerre n'ont été aussi vifs chez autant d'hommes.
2. Les causes de la coexistence pacifique. La coexistence pacifique s'est instaurée à la faveur des éléments suivants : Le changement d'hommes politiques aux EU et en URSS. En URSS après la mort de Staline le 5 mars 1953, ses successeurs montrent leur volonté de paix et de dialogue avec les dirigeants du bloc occidental.
PUISSANCE ET CONFLIT DANS LE MONDE DEPUIS 1945 Chapitre 3 : La coexistence pacifique et la détente. Introduction Les Relations Est-Ouest évoluent progressivement de la coexistence pacifique à la détente. Les origines de cette Détente sont en partie les mêmes que celles de la coexistence pacifique, mais on est désormais d'autant plus ...
La coexistence pacifique. Ressources (17) Résultats par page. 25. Consulter. Partager. Twitter Facebook Email. "La coexistence pacifique" dans Luxemburger Wort (14 mars 1953) Texte. Le 14 mars 1953, le quotidien catholique Luxemburger Wort s'interroge sur les possibilités d'établir une coexistence pacifique entre l'Ouest et l'Est. Consulter.
Précédent Chapitre I. Pensée militaire soviétique et coexistence pacifique Suivant. Chapitre I. Pensée militaire soviétique et coexistence pacifique. p. 25-57. Plan détaillé. Texte intégral. 1 La prépondérance de l'Union Soviétique modèle tous les domaines au sein du bloc qu'elle forme avec ses alliés.
Guerre froide et coexistence pacifique (1948-1962) Stanislas Jeannesson. Dans La guerre froide (2014), pages 35 à 58. format_quote Citer ou exporter Ajouter à une liste. Article. Plan. Auteur. Sur un sujet proche. Acheter. La question allemande évolue de façon décisive dans les années 1948-1949.
La coexistence pacifique ouvrit la voie à une nouvelle ère dans les relations internationales. À la guerre froide succéda la détente (1962-1975), période durant laquelle les rapports américano-soviétiques connurent une certaine embellie. 2. Les causes de la coexistence pacifique. 2.1. De nouvelles conditions internationales.
La coexistence pacifique (1955-1962) Suivre cet auteur Maurice Vaïsse. Dans Les relations internationales depuis 1945 (2017), pages 53 à 76. format_quoteCiter ou exporterAjouter à une liste. Chapitre. Plan. Auteur. Chapitre. Les années 1955-1956 ne sonnent pas la fin du monde bipolaire né au lendemain de la Seconde Guerre mondiale.
Dans l'action pour la paix, l'idée-force de la coexistence pacifique est appelée à jouer un rôle de plus en plus important. En essayant d'en éclairer certains aspects théoriques, j'ai voulu également apporter une modeste contribution à cette action. Janvier 1962. MARX.
La coexistence pacifique, l'idéologie et le dialogue 73 cesse d'être avantageuse et la guerre mondiale devient non seule-ment une entreprise hasardeuse, mais carrément de la démence. Il est vrai que la guerre, de même que la démence, ne peut pas être exclue, mais son irrationalité comporte des implications politiques dont nous retrouvons les effets dans la fortune mondiale à ...
INTRODUCTION: Au début des années 50 des signes de détente (de "dégel") apparaissent entre les deux grands après la difficile période de la formation des blocs. Le changement des hommes n'est pas étranger à ces nouveaux rapports puisque c'est Khrouchtchev qui en 1956 évoque la coexistence pacifique.
1963-1964 : la coexistence pacifique et le basculement des périphéries. Études Le XXe siècle en dix fins d'année. Fin de l'année 1963. La coexistence pacifique semble à son apogée. En fait, elle n'a jamais été aussi fragile.
Informations du cours. Droit international de la coexistence pacifique. En 1945, le nouvel ordre mondial fondé par la Charte des Nations Unies entend faire de la paix le 'bien' juridique suprême, et mettre ainsi fin à la répétition historique.
La quête de la paix, aussi ancienne que l'humanité elle-même, nous interpelle avec une urgence renouvelée.